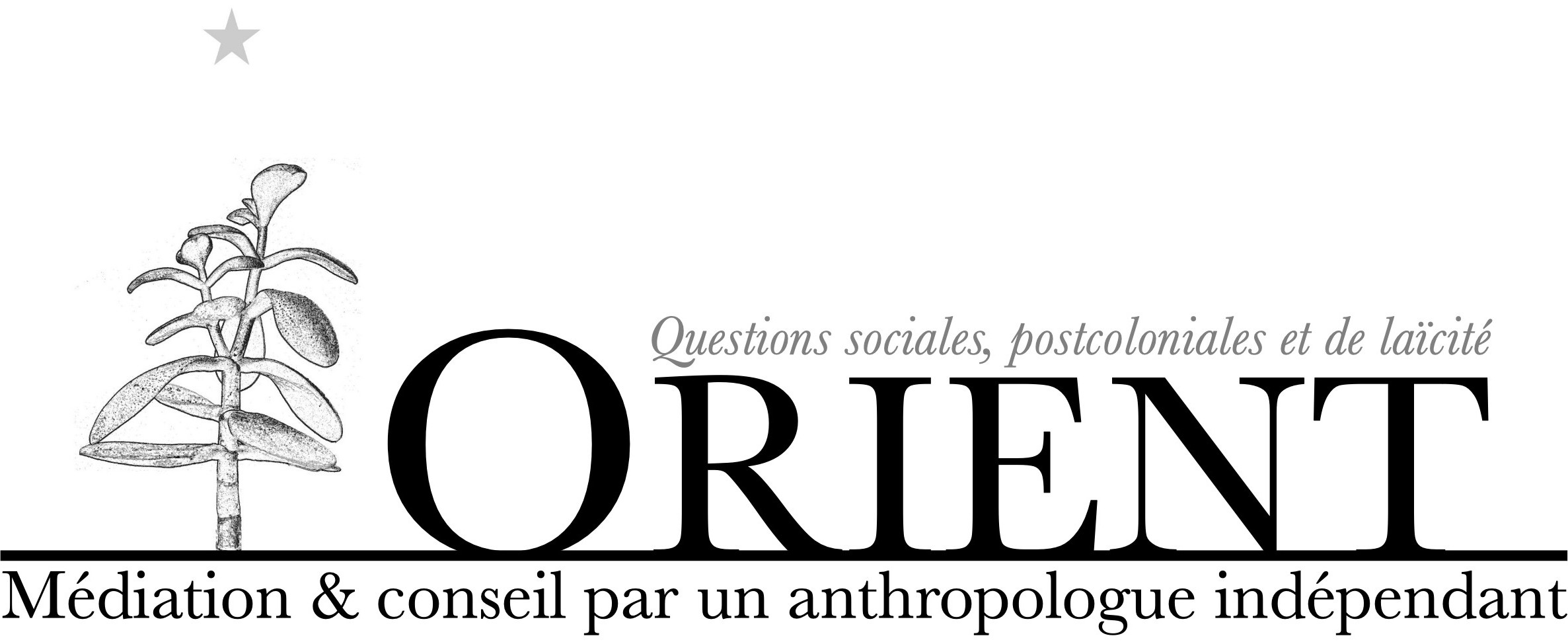 La société française est aujourd’hui agitée par un refus légitime du « communautarisme » et du « multi-culturaliste » anglosaxon. Mais en pratique, les personnes disposent de peu de ressources pour penser de manière non-culturaliste, pour donner sens à l’expérience autrement qu’en termes de différence « culturelle » (ou « religieuse »). L’éclairage des sciences sociales anti-culturalistes vous aide à dénouer le dialogue social dans votre entreprise ou votre institution, en construisant votre propre solution médiane face aux contentieux postcoloniaux. Mon expertise s’appuie sur une décennie d’expérience et d’observation sur ces problématiques dans la société française (spécifiquement dans l’Hérault depuis 2014), après une décennie de recherche en anthropologie dans la société yéménite (en immersion trois mois par an entre 2003 et 2010). Pour avoir su garder le fil de ces deux terrains d’intervention, je dispose aujourd’hui d’une vision synthétique originale, rompant avec les déterminismes sociaux et culturels, mais plutôt axée sur la relation (analyse des interactions, anthropologie systémique, épistémologie). PhilosophieJe propose une gamme de prestations combinant formation, médiation sociale et conseil, soit auprès de professionnels spécialisés (travailleurs sociaux, médiation urbaine, police, justice…), soit auprès des entreprises dans le cadre de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). L’objectif général est de déculturaliser les situations - voire parfois les déconfessionnaliser - notamment grâce aux ressources du recadrage. Dans toute situation conflictuelle, les protagonistes ont tendance à penser que la situation qu'ils vivent, bien que problématique, s’inscrit dans un certain « ordre des choses ». C’est cette compréhension du monde qu’il s’agit de faire évoluer (et la mienne continue d’évoluer aussi…). L’apport d’information concernant d’autres situations, en d’autres temps et d’autres lieux, fait progresser l’exploration « expérimentale » du cas considéré. L’intervention fait donc une place à l’évocation des affaires qui font l’actualité - questions géopolitiques, nature des conflits moyen-orientaux, affaires terroristes, polémiques internes à la société française - qui sont évoquées sous l’angle des processus et des structures relationnelles, plutôt que sous celui des identités ethniques et confessionnelles. Pour mobiliser des références plus positives, je mène également un travail autour de la notion d’Orient, particulièrement occultée à notre époque (depuis les Décolonisations), mais qui reste un élément central pour une compréhension partagée et laïque du monde contemporain. Enfin, l’intervention débouche sur un diagnostique plus général sur l’état de notre démocratie, ainsi que sur le statut des sciences sociales dans notre société, plus d’un demi-siècle après les Décolonisations. À des fins pédagogiques, j’introduis la figure du sociologue sur le terrain, illustrée par ma propre expérience au Yémen, et ma découverte des rapports entre position de l’observateur et régimes arabes post-coloniaux (en amont des Printemps Arabes de 2011). J’introduis alors la « psychose » spécifique du chercheur en sciences sociales, lorsqu’il croit sincèrement interagir avec les catégories qu’il manipule. Le culturalisme relève de cette erreur logique fondamentale, qui consiste à classer ensemble le nom et la chose nommée (ou « manger la carte à la place du repas », comme dirait l’anthropologue Gregory Bateson). Cette « psychose du sociologue », angle-mort de la recherche universitaire et des institutions internationales, concerne aussi la France de la Vème République, car elle est constitutive d’un ordre global né en 1945, aujourd’hui en pleine mutation. Une fois pointé ce phénomène, la stigmatisation de l’islam et des musulmans n’apporte rien : elle ne fait qu’empêcher l’adaptation de la société française dans le tournant historique que nous traversons. Une mise à jour s’impose, et ce défi ne peut être relevé qu’au bas de l’échelle : entre les institutions du « social » et leurs bénéficiaires de toutes confessions, dans les services publics et dans l’enseignement, mais aussi sur les lieux de travail. L'offre de services1. Volet Formation :
2. Volet Médiation Sociale :
3. Volet Conseil :
Mon parcoursNé en 1980, je grandis au sud de la région parisienne. Initialement de formation scientifique, j’apprends l’arabe depuis ma première année de maths sup (1998-1999). En 2000, j’intègre l’Ecole Normale Supérieure par le concours physique. Je découvre le Yémen en juillet 2001 lors d’un stage linguistique avec la classe d’arabe de l’ENS, et peu après les attentats de New York je décide de me reconvertir. Je reçois une formation généraliste au département de Sciences Sociales de l’ENS, parallèlement à un cursus d’anthropologie à Paris X – Nanterre. Je commence ma thèse en 2005, sous la direction de l’historienne et anthropologue Jocelyne Dakhlia (EHESS). À partir de l’été 2003, je mène des séjours d’immersion ethnographique à Taez, la troisième ville du pays (un million d’habitants), située entre Sanaa et Aden. Ville moderniste et sans histoire, Taez est tournée vers le commerce, l’enseignement supérieur et les migrations, domestiques ou internationales. Si je choisis cette ville, c’est dans l’espoir de construire des relations intellectuelles symétriques autant que possible. Au fil de mes recherches (sept longs séjours entre 2003 et 2010), j’étudie le fonctionnement de la sociabilité masculine urbaine, en lien avec les mutations de l’honneur et l’histoire sociale locale, tout en décryptant les mécanismes de l’illusion sociologique. En 2009, je reçois l’encouragement du Prix Michel Seurat (CNRS). En 2011, à la surprise de tous les observateurs, Taez prend la tête du Printemps Yéménite. À cette époque j’ai déjà décidé de me retirer par respect pour mes principaux interlocuteurs - je dois d’abord soutenir ma thèse - et la Révolution ne fait que renforcer ma détermination. Finalement trois ans plus tard, je suis contraint d’abandonner mon travail. Début 2014 je déménage à Sète. Je travaille essentiellement comme enseignant en mathématiques, tout en me formant sur les questions de laïcité (DU « Religions et Société Démocratique » en 2017, à la Fac de Droit de Montpellier). En 2015, la guerre éclate au Yémen entre le camps pro-Iranien (basé à Sanaa) et le camps pro-Saoudien (basé à Aden), Taez devenant le point le plus chaud de la ligne de front. Soumise au blocus et aux bombardements, la ville se vide de ses habitants. Traversée par une ligne de front comme le Berlin de la Guerre Froide, la ville demeure synonyme d’espoir pour ceux qui espèrent une solution au conflit. Depuis 2019, je renoue progressivement avec la communauté académique. Je me réinvestis parallèlement dans l’action citoyenne, depuis fin 2018 et l’irruption du mouvement Gilet Jaune. Je fonde OrientMC en 2021. OrientMC,
c’est la proposition d’un Français passé par l’Orient, et
qui en est revenu, mais qui reste enraciné là-bas jusqu’à
aujourd’hui. De cet enracinement, je tire une certaine
intuition du mal-être de mon pays natal, l’épuisement de
cette époque postcoloniale qui a prétendu abolir l’Orient.
Je tire une certaine compréhension de la faillite
structurelle des sciences sociales, inscrite dans leur
langage-même, et dans l’approche du « social » plus
généralement. Je tire enfin quelques techniques pour nous
remettre la tête sur les épaules, et l’intuition d’un
chemin partagé.
par Vincent Planel,
anthropologue indépendant
|
|||
|
Première
mise en ligne le 4 décembre 2020. Je paufine peu à peu
cette présentation, dans la perspective de cette
activité. Textes et images mis
à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons |
|||
