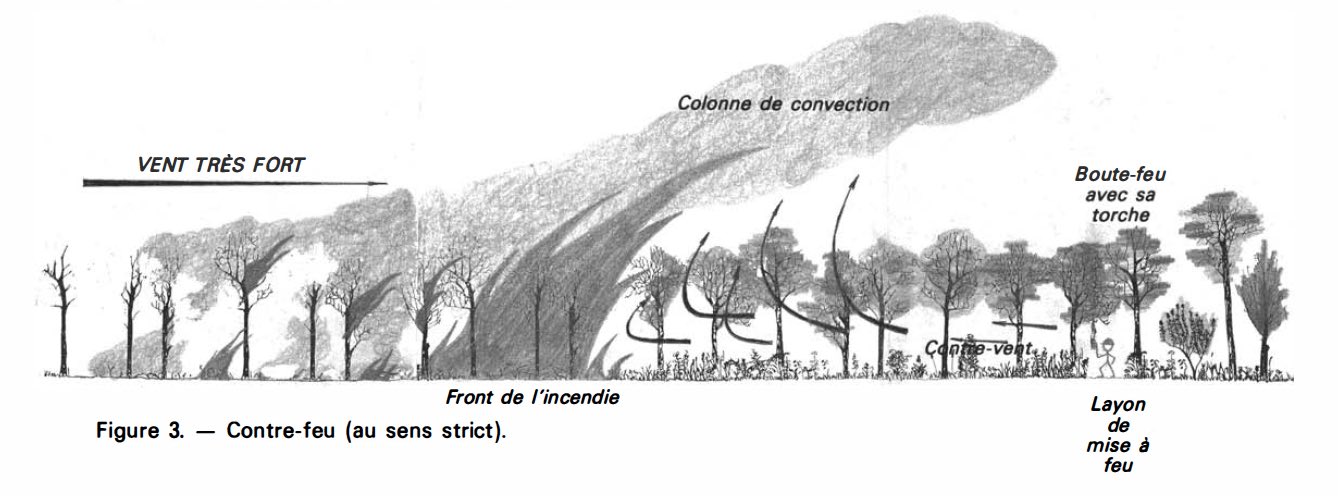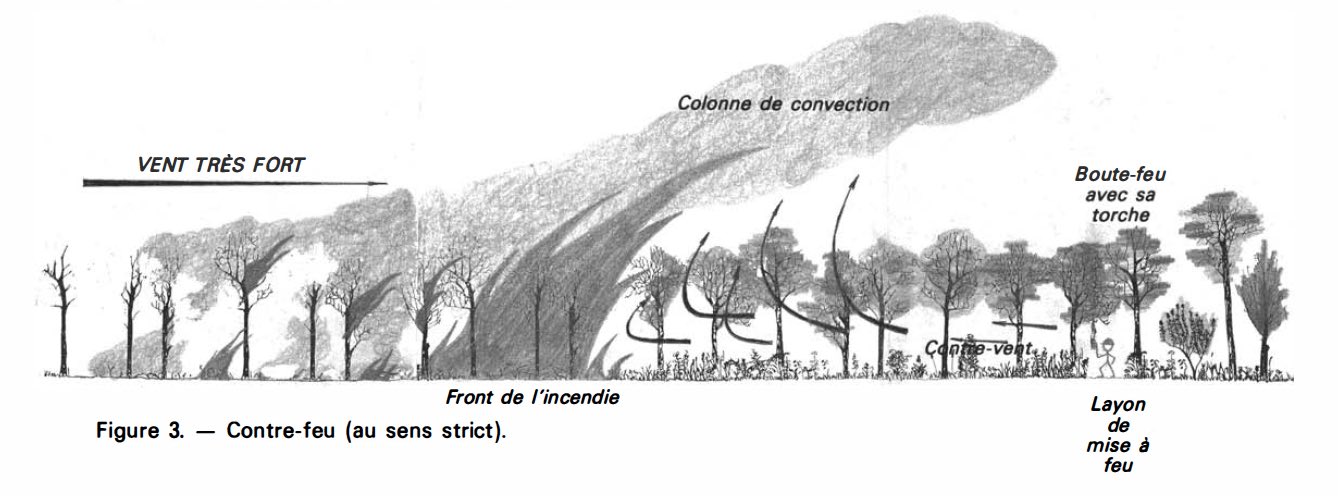« Homoérotisme » : un jihad ethnographique (introduction)
25 juin 2020. Introduction
d’un texte en cours de construction, pour une
publication en anglais, présent ant
synthétiquement mo n
travail en axant
d’emblée sur la notion “d’homoérotisme”.
1.
Le
1 er avril 2006, je
suis allé chez le coiffeur à l’entrée du souk al-samil, près du
carrefour de Hawdh al-Ashraf. Le coiffeur a demandé ce qu’on faisait
avec ma moustache.
- E nlève
là . Complètement? Au rasoir? - Oui au rasoir.
Je suis sorti dans
la rue, avec ma coupe toute propre et mes lèvres de sucre. Les
commentaires ont été nombreux.
J’étais arrivé au
Yémen au mois de février pour un troisième séjour d’immersion, le
premier dans le cadre de ma thèse. J’avais alors l’espoir de renouer
avec Ziad, le héros de ma première enquête, qui restait pour moi un
interlocuteur important. Mais après quelques semaines de cohabitation,
Ziad m’avait finalement demandé de partir. Alors j’ai rasé ma moustache.
Ça a été ma réponse.
On m’avait toujours
dit : « Ne rase pas ta moustache, au Yémen
ça ne se fait pas ». Et moi j’avais toujours pris soin de
laisser quelque chose, au moins un demi-millimètre. Tout comme je
m’efforçais de m’habiller comme les Yéménites, de respecter les normes
de pudeur, d’adopter leurs codes, de ressentir les choses comme ils les
ressentent. Au Yémen j’étais constamment à l’école - c’est une
partie importante du travail d’un anthropologue sur le terrain, ce
qu’on appelle l’« observation participante ». Mais ce
jour-là Ziad m’avait demandé de partir. C’était un jour grave, et
j’avais juste envie d’être moi. D’ailleurs cette
posture a été bien reçue, globalement, en tous cas elle m’a permis
d’exister, d’établir des échanges beaucoup plus profonds avec la
société yéménite. Tourner le dos à Ziad était le prix à payer. Q uand
je quitte le Yémen quatre mois plus tard, mon enquête a pris un nouveau
départ et j’ai gagné beaucoup d’assurance. En
fait ce jour a été un tournant.
2.
Le
19 août 2007, je reviens à Taez après un an d’absence. Je prends le
bus depuis Sanaa au petit matin, et j’arrive vers midi sur la place du
Hawdh al-Ashraf. Je ne vais pas d’emblée saluer Ziad dans son
quartier, car je veux marquer une distance. Je sais qu’entre temps, la
famille de Ziad a été frappée par des malheurs. En toute logique, je
devrais lui porter mes condoléances, mais je n’y pense même pas car je
me sens coupable - en fait j’ai confusément peur qu’il ne s’en
prenne à moi. Je passe l’après-midi avec les commerçants, qui sont
maintenant mes alliés dans mon travail. Peu après la tombée de la
nuit, je vois des jeunes courir sur le carrefour en direction du
quartier du dessus, et la rumeur d’un incendie arrive jusqu’à nous. Du
coin de l’avenue, j’aperçois une fumée noire au-dessus de la maison de
Ziad. « Il a fait ça pour que je me
convertisse ! », je me dis sur le
moment…
Par
la suite, j’apprendrai une réalité beaucoup plus prosaïque. Après le
décès accidentel de son grand-frère Nabil, Ziad a été interné en
hôpital psychiatrique car il refusait de reprendre son poste à la tête
de la police des souks. Son petit frère Yazid s’était marié deux ans
plus tôt : il avait déjà une petite fille, et un petit garçon
était en route. Yazid aurait voulu travailler pour les nourrir, mais
lui n’avait simplement pas les épaules. Évidemment, les électrochocs
n’ont pas fait changer d’avis Ziad, et la famille a dû se résoudre à
voir le poste partir à un cousin. Depuis ce jour, Ziad menaçait de se
venger en mettant le feu à la maison. Il avait juste attendu mon
retour, puis s’était laissé emmener en prison.
Le soir de
l’incendie, je fais profil bas. Je viens d’arriver, je ne saurais pas
quoi dire, je suis déjà couvert de honte. Les Yéménites aussi font
semblant de ne pas voir la coïncidence : il règne une ambiance de
non-dit, comme dans une intrigue de sorcellerie.
Dans les semaines qui
suivent, je me réinstalle dans mes habitudes yéménites, sur le mode
enjoué qui caractérise mes rapports avec les Yéménites. Mais quand je me
retrouve devant mon ordinateur, essayant de lancer la rédaction de ma
thèse, je réalise que je ne peux pas continuer comme avant, je ne peux
pas m’assoir sur ce qui s’est passé. Quand arrive le mois de ramadan, je
commence à faire la prière dans ma chambre d’hôtel. Puis chez Lotfi
et ses frères, les amis commerçants
avec lesquels je vais rompre le jeune, je rejoins la
prière collective . Après quelques jours je rentre dans la
mosquée, sans rien demander à personne. On vient m’interroger, savoir si
je me suis vraiment converti : je dis oui, et je prononce la double
profession de foi à qui veut l’entendre . Mais
je ne veux pas d’une cérémonie en bonne et due forme. Je veux qu’ils
sachent que ça s’est joué ailleurs.
Pourtant
aujourd’hui - et c’est un peu
paradoxal - je reste obsédé par mes aventures au Hawdh al-Ashraf,
l’endroit où s’est joué cette conversion.
3.
Au fil des années,
j’ai échoué à devenir un musulman « normal » dans la société
française. Il faut croire que je n’ai pas géré l’immersion comme les
autres convertis, du fait qu’il y avait eu ce précédent dans la société
yéménite. J’ai refusé de jouer c e jeu de
« l’observation participante », que tous les musulmans
d’aujourd’hui jouent un peu malgré eux.
Moi, ça ne m’intéresse pas de construire l’islam comme un pays
merveilleux, dont nous serions tous les émigrés clandestins. Ça
m’intéresse de vivre dans un monde où l’on ne m’expliquerait pas, à moi,
que Ziad est « schizophrène ». Un monde qui aurait su tendre
la main à Taez en 2011, et qui ne se serait pas résolu à ce que cette
ville soit rayée de la carte quelques années plus tard. Un monde dans
lequel le Hawdh al-Ashraf ne serait pas aujourd’hui une
zone commerciale désertée, au bord d’une zone minée gardée par des
snipers.
Ces
dernières années, les évolutions du monde m’ont conforté dans l’idée
que j’étais sur le bon chemin. Mais à l’origine, je n’ai fait que
défendre l’intégrité de ma pensée, la cohérence de mon cheminement
logique.
L’une
des raisons pour lesquelles j’ai refusé de recevoir le
« baptême » de la société yéménite en septembre 2007, est la
question homosexuelle. J’avais établi un dialogue avec cette société
en termes d’ homoérotisme :
d’une part un dialogue tacite avec les Yéménites du carrefour (depuis
ce jour où j’avais rasé ma moustache…), d’autre part un dialogue
intellectuel explicite, avec ceux de mes interlocuteurs qui étaient
versés dans les sciences sociales, avec lesquelles je pouvais partager
mes analyses. Ce dialogue était important pour
moi, cette thèse que je m’efforçais de construire, il y avait là un
fil d’Ariane qui me rattachait à ma société d’origine. Cette thèse, je
l’écrivais dans ma langue maternelle qui était le langage de ma
sincérité, et c’est dans cette langue-là que je m’étais converti. Le
terme « homoérotisme » démontrait déjà en lui-même une forme
de pudeur, et je n’avais pas de raison d’abandonner cette recherche.
J’avais toujours été très clair, ma recherche ne portait pas sur la
sexualité des Yéménites, plutôt sur les résonances de cette thématique
dans la vie sociale, et dans ma propre perception subjective de
celle-ci.
Si j’avais accepté
une cérémonie de conversion, j’aurais rejoint une communauté qui ne
pouvait pas accueillir ce dialogue. Je me serais placé sous l’autorité
spirituelle de personnes, les religieux militants, qui n’en avaient
jamais fait partie : soit parce qu’elles considéraient les sciences
sociales comme vectrice d’une perversité intrinsèque, soit parce que
l’objet de mon enquête en lui-même, l’espace public et commercial du
souk, leur inspirait une réprobation globale. À partir de ma conversion,
j’ai commencé à m’entretenir beaucoup plus régulièrement avec ces
personnes religieuses. J’ai accosté aux berges de leur pays, mais cela
n’aurait pas eu de sens de rejouer
l’immersion par observation participante. J’ai plutôt laissé l’islam
transformer les relations qui constituaient mon enquête, celles qui
m’avaient guidé jusqu’à l’islam, afin qu’elles continuent de me guider
au-delà.
Peu à peu, au sein de
ces relations qui constituaient mon enquête, une pudeur a fait jour.
Quand je suis revenu à Taez en 2008, après une première année assez
difficile passée en France comme musulman, le carrefour du Hawdh m’était
devenu insupportable et j’y restais le moins possible. Cette année-là,
j’ai vécu une réconciliation générale avec le quartier de Ziad et avec
sa famille. Mais rapidement, j’ai réalisé qu’il me fallait rentrer en
France pour rédiger ma thèse : je ne pouvais pas revenir avant
d’avoir un travail, un vrai statut de chercheur, pour pouvoir réellement
les soutenir. Ma responsabilité était d’abord de mettre un terme à la
folie de Ziad, en lui donnant sa place définitive dans l’histoire. Deux
visites ultérieures, en 2009 et en 2010, m’ont convaincu plus encore de
la nécessité d’assumer ma responsabilité, et accru encore mon dépit à
l’égard d’une société yéménite qui ne m’y aidait pas. Quand je quitte
Taez pour la dernière fois, en novembre 2010, j’ai au moins la
satisfaction d’avoir été chassé du quartier de Ziad, en tant que celui
qui l’a rendu fou. En contre partie de mon départ, son frère Yazid
s’engage à ne plus jamais le renvoyer en prison. Quelques semaines plus
tard c’était l’irruption des Printemps Arabes, et celle de Taez, au
centre du jeu politique yéménite.
4.
[L’ouvrage collectif
a pour thème : « des mots et des mondes ». En lien avec
la situation actuelle au Yémen, il s’agit de raconter comment un concept
de sciences sociales a pu servir de pivot entre deux mondes…].
Il y a bien un
déplacement dans ma compréhension de « l’homoérotisme », tel
que j’ai commencé à en faire usage dans les années qui ont suivi ma
conversion à l’islam, par rapport au moment où je m’en étais saisi dans
mon enquête.
Au
moment où j’ai rasé ma moustache, j’avais été marqué par des travaux
portant sur « l’homoérotisme » des sociétés islamiques
passées et présentes, qui insistaient sur la relativité des
conceptions du genre et de la sexualité. Je renvoie à l’article de
synthèse publié peu après par Jocelyne Dakhlia, qui était alors ma
directrice de thèse : « Homoérotismes
et trames historiographiques
du monde islamique » (2007). J’étais
alors confronté à une impasse dans mon enquête, et ces travaux m’avaient
suggéré l’existence d’un au-delà des apparences, un espace des possibles
où je pourrais rejouer l’histoire. L’idée que les choses auraient pu se
terminer autrement, si j’avais été moins rigide quant à ma propre
sexualité, et aussi que peut-être il n’était pas trop tard.
Je ne me serais jamais lancé dans cette
littérature sans ma confiance en Jocelyne Dakhlia, qui dirigeait mon
travail depuis l’année précédente. Car pour moi, je ne me serais jamais
aventuré à la légère dans les questions de genre. Étant de formation
scientifique, je me méfiais énormément des sciences sociales fondées
exclusivement sur l’analyse des discours, comme sont la plupart des
études sur ce thème. Je voulais faire de la « vraie
sociologie », travailler sur des situations réelles d’interaction
sociale. Plus généralement je n’avais pas confiance : l’imprécision
empirique de ces études me semblait incompatible avec l’exigence
théorique que je souhaitais pour mon enquête. Mais il s’est trouvé que
ma directrice s’aventurait sur ces questions, à un moment où je savais
que je pouvais avoir confiance en elle .
Je me suis saisi de ces études sur le plan
théorique, en ayant en tête instinctivement ce qu’elles me permettraient
une fois de retour sur le terrain - à savoir, allumer un contre-feu :
admettre que j’étais tombé dans le piège de cette catégorie, pour mieux
m’en extraire. C’est ce que j’ai commencé à faire le jour où j’ai rasé
ma moustache.
Source : Guy B enoit
de Coignac, « Le
contre-feu : est-ce la seule technique efficace d’extinction des
grands incendies ? » Forêt
méditerranéenne VIII, n o
2 (1986): 167‑72.
Du moment où j’utilise ce terme, du moment
où j’arbore cette absence de moustache, j’admets être habité par
l’empreinte d’une expérience homosexuelle. Mais par le fait que je
commence à l’utiliser publiquement, je décide que je n’ai pas à en avoir
honte. En quelque sorte, je me convertis à l’homosexualité des
Yéménites : quelque chose que moi
j’appelle homosexualité, mais qui appartient aux Yéménites et qui me
relie à eux. Au moment où je franchis ce pas, je n’ai aucune conscience
des implications de cette stratégie. Je suis au Yémen depuis six
semaines, j’ai le nez dans le guidon, et c’est la situation elle-même
qui m’accule à ce choix.
Tout cela est la conséquence d’un nœud, qui s’est mis en
place en 2003 lors de mon premier séjour. C’est ce que je vais décrire
dans la suite du texte, en me focalisant sur l’histoire de la famille de
Ziad et sur son inscription dans le
quartier du Hawdh al-Ashraf, puis le déroulement de mon premier terrain,
ce « petit printemps arabe » centré sur ma subjectivité, et les
conséquences de cette expérience sur mon passage à l’écriture.
En attendant, voir « Les
clés de mon enquête au Yémen » .
phpMyVisites | Open source web analytics