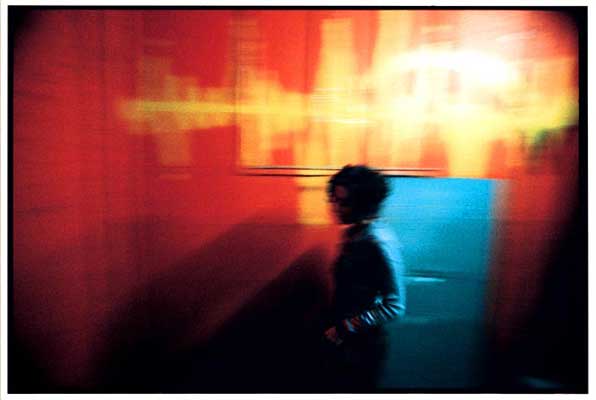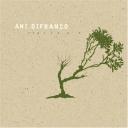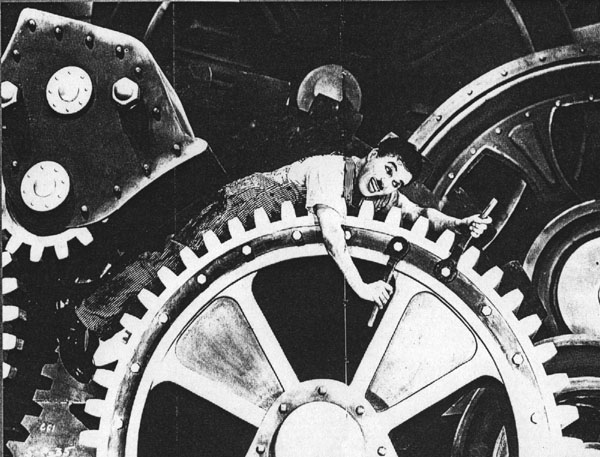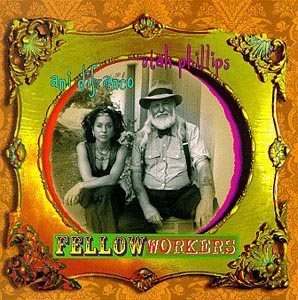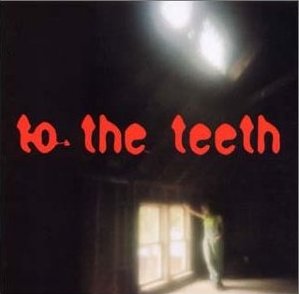« Je ne viendrai pas m’allonger moi-aussi
sur des soubassements truqués de part en part,
En ces temps où il sonne encore “radical” d’appeler un chat un
chat. »
A spade (2006)
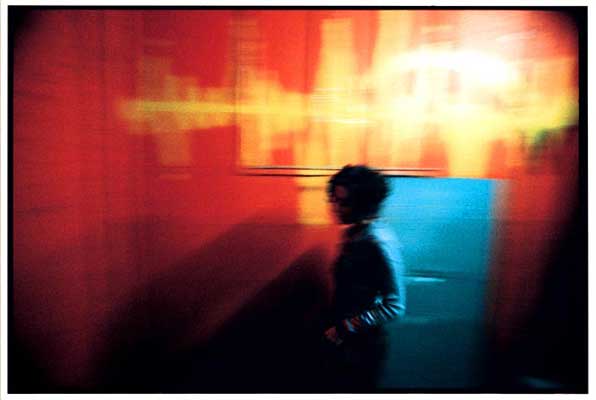
Voici une longue note, à partir de « a
spade », une chanson du dernier album que j’aime
énormément (paroles
ici). On pourrait s’amuser à recenser les
passages où AD adopte le langage des sciences sociales (révolte
contre le QCM normalisé : la réponse est fonction de la
question…), ou encore s’interroger sur la manière délibérément
hallucinée dont elle mobilise le féminisme (« Quand
finirons-nous par faire enfin tourner la roue de l’histoire
humaine ? »). Mais je voudrais surtout faire un commentaire sur
la forme, qui ici rejoint le fond.
La chanson se présente comme un mélange assez
étrange, baroque peut-être, de divagations philosophiques,
existentielles et politiques, le tout baigné dans une musique
délibérément mystérieuse et oppressante. Une atmosphère de
cauchemars, en somme. Ou peut-être la lucidité si particulière
d’un rêve éveillé, qui lui laisse entrevoir le « dénominateur
commun des guerres de l’Histoire »…
Ani Difranco vit les drames de son époque à la première
personne. Cela était déjà particulièrement évident dans le poème
« Serpentine »
(2002), qui s’ouvre sur ces mots : « Dès que je réponds au
téléphone, Pavlov m’envoie au visage d’autres mauvaises
nouvelles, alors quand je suis à la maison je le laisse sonner
et puis je joue, je chante… ». Le propos est difficile, vraiment
pas sexy ; la chanson agonise dans une sorte de gémissement…
Personnellement j’adore le solo introductif de la chanson, je le
trouve magnifique… mais généralement je zappe. « A Spade »,
c’est autre chose, la sublimation est d’un autre ordre. Au
Yémen, je l’écoute en fermant les yeux, le casque sur les
oreilles ; ici je monte le volume de la chaîne…
Que s’est-il passé entre 2002 et 2006, durant
ces années de guerre en Irak ? Alors qu’apparemment en 2002 il
lui arrivait de « ne pas répondre au téléphone », elle s’est
trouvée propulsée comme la muse du mouvement
pacifiste américain. En témoigne par exemple le livre d’Antonio
Negri « Empire », qui s’ouvre avec cette citation de « my IQ »
(1993) : « Every tool is a weapon, if you hold it right ». Mais
on peut aussi prendre la mesure du phénomène en regardant les
films militants : le film d’Amy Goodman dont je parle ailleurs,
ceux de Michael Moore il me semble ; on m’a parlé aussi du
« monde selon Bush »… Bref, Ani Difranco est devenue la
bande-son qui s’impose, la voix d’une Amérique sans voix face au
spectacle des enfants irakiens déchiquetés. Elle est donc à
présent, dans sa personne même, un rouage
du Drame (cette situation, j’aime la rapprocher de celle d’un
ethnologue faisant l’expérience personnelle, dans son corps, du
« choc des civilisations » - c’est là au fond le propos de ce
blog).

Bien entendu, l’exposition particulière d’Ani
Difranco modifie nécessairement la manière dont elle vit
l’actualité et en parle. Les enjeux deviennent d’un autre ordre
(d’où l’injonction à « s’y
mettre » de 2005). Pour saisir l’ampleur de la
métamorphose, il n’y a qu’à repenser à sa fébrilité au moment de
lancer « Self-evident » au visage du public New-Yorkais quelques
mois après le 11 septembre 2001 (qu’elle évoque dans l’enregistrement
de Carnegie Hall). A présent, cette gêne a
manifestement disparu : pour vous en rendre compte, allez voir
cette vidéo-pirate
de « your next bold move » en 2007. Il y aurait vraiment
une analyse à faire de ce mélange d’informel et de gravité, de
la manière dont elle négocie la chanson, dont elle la
« performe », et de ce que cela dénote du mouvement qu’elle
parvient à incarner. Or cette gestion est avant-tout d’ordre
personnel : une renégociation de l’intimité, dans des
circonstances où elle se trouve dans une certaine mesure
dépossédée d’elle-même. C’est dans ce cadre qu’il faut
comprendre le « glissement prophétique » auquel on assiste dans
l’album « reprieve ». Ani Difranco ne peut plus parler de la
guerre à la première personne, il lui faut à présent mobiliser Hiroshima,
la Grande Roue de l’Histoire Humaine et la Maternité Féconde,
seule garante du Renouveau (chez quelqu’un qui, par
ailleurs, prend régulièrement position pour défendre le droit
à l’avortement) :
« Feminism ain’t about equality, it’s about
reprieve ».
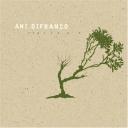
Mais la question que je voudrais poser est :
pourquoi elle ? C’est là la question intéressante, consistant à
aborder le phénomène en micro-historien, comme Giovanni
Levi avec son « exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle ».
Pourquoi précisément cette chanteuse a-t-elle assumé ce
rôle-là ? Pourquoi est-ce elle, de tous les musiciens partageant
son envergure, qui a su produire un poème comme « Self-evident »
dans ces circonstances historiques précises ? La réponse se
trouve largement dans la trajectoire d’Ani Difranco, dans une indépendance
dont souvent on ne mesure pas l’importance, tant nous sommes au
fond accoutumés à l’asservissement de l’expression artistique, y
compris sous ses formes “militantes”.
La profondeur du malentendu peut s’observer avec « A Spade »,
dans cette forme « baroque » et dans les réserves qu’elle
suscitera chez un auditeur français qui, n’aillant pas suivi
l’histoire depuis le début, trouvera tout cela assez écœurant et
manquant franchement de subtilité. S’il y a quiproquo, c’est que
l’auditeur français s’attend en fait intuitivement à un exercice
de style, répondant aux critères propres de la « chanson
engagée » : caractère inachevé, « brouillon », « spontané » ;
une chanson trop “léchée”, ça fera chanson humanitaire de
supermarché… C’est qu’il y a en France une manière légitime
d’être politisé : un ton adapté, peut-être surtout une posture
et une « juste distance »… Ces critères doivent exister, faute
de quoi nous serions bien en peine de distinguer la
« véritable » chanson engagée de celle que nous entendons en
faisant nos course, quand Virgin et Monoprix, main dans la main,
nous expliquent quoi penser de la « petite
fille Afghane de l’autre coté de la Terre ».
Sauf que par la censure qu’ils exercent, ces (contre-)critères esthétiques ménagent
finalement une modalité réglée de l’engagement, qui contribue à
son tour à brouiller les pistes.
C’est là que j’en viens à Bateson : appeler un chat à chat,
c’est d’abord être capable de produire un cri, et pas seulement
ce qui le dénote. Au sens où Gregory Bateson, dans sa « théorie
du jeu et du fantasme », observant de jeunes singes en train de
jouer au zoo, explique que « le mordillage ludique dénote une
morsure, sans pour autant dénoter ce que dénoterait une
morsure » (p.250 de « vers une écologie de l’esprit »). De même
que les boutades « homoérotiques », au sein des groupes
masculins de pairs, dénotent l’homosexualité sans pour autant
être équivalentes à une homosexualité effective ; la vraie makhnatha
commence quand on ne sait plus faire la différence entre les
deux. Lorsqu’on ne distingue plus la contestation de ses
attributs conventionnels, parce qu’il importe surtout de savoir
se moquer, avec les Inconnus, des « Florent
Brunel » en tous genre… Ou encore lorsque tout
le monde semble croire qu’il suffit, pour déréaliser la guerre
en Irak, de ne pas être dupe des effets de réel produits par
CNN.
Je dérive et je commence à être long… Le fond
du problème, c’est combien l’inflation de médiatisation (au sens
anthropologique) qui caractérise la modernité occidentale rend
problématique le témoignage lui-même (tout comme l’honneur…).
Cela vaut pour une chanteuse engagée comme pour un ethnographe,
potentiellement un « circumstantial
activist » lui-aussi. Sauf qu’aujourd’hui en France, le
seul prof dans mon cursus d’anthropologie qui m’a préparé à ce
genre de questions, c’est Rémo Guidieri, et manifestement les
gens de Nanterre le considéraient comme un vieux fou… Alors ma
foi, heureusement qu’Ani Difranco est là, avec ses cauchemars
grandiloquents, qui sont aussi les miens.
Dear
friends, women and men, what better time to face
That we’ve been looking for the answer to war in the wrong
place.