Mon
mariage
avec les sciences sociales
de l'Ecole Normale Supérieure à l'Alternative Sétoise
Texte
rédigé à partir du 7 mars 2020, suite à mon retrait de ce
mouvement pour les municipales, à quelques jours du scrutin (15
mars).
Encore en chantier, il est mis en ligne essentiellement à
destination de mes proches et des petits camarades militants qui
auraient la curiosité de me comprendre.
Si
vous cherchez ce que je pense de l’Alternative Sétoise, vous
êtes au bon endroit (il faudra juste zapper la partie I).
Pour résumer, je pense que l’Alternative Sétoise était à
l’origine un mouvement particulièrement riche, qui rassemblait
des démarches diverses, et tout à fait interessantes. Des gens
qui ont derrière eux toute une trajectoire professionnelle dans
les institutions du "social" (pour dire vite), et aussi des
électrons libres, des marginaux, qui entretiennent un rapport
bien plus douloureux à ces institutions. Moi je me suis engagé
dans ce mouvement pour régler mes comptes avec la Gauche (mon
milieu d’origine), et pour négocier mon divorce avec les
sciences sociales. Donc c’est ce que je raconte dans ce texte,
en racontant un peu ma vie : l’histoire d’un mariage
malheureux…
Si je raconte cette histoire, c’est qu’on continue jusqu’à
présent de me prendre pour un fou, de penser que le problème
vient de ma conversion à l’islam et de ma
« radicalisation ». Et moi je crois qu’au contraire,
c’est la société française toute entière qui est emprisonnée
avec les sciences sociales, dans une relation matrimoniale
particulièrement abusive, et que la gauche est en fait le nœud
du problème. Quant à l’islam, il n’est ici qu’une position pour
observer ce drame : une position stratégique, mais une
position parmi d’autres… J’ai rêvé que l’Alternative Sétoise, à
travers une compréhension renouvelée de la laïcité, soit le
creuset où puissent s’élaborer d’autres perspectives pour la
société française. Ce rêve a beau être démenti par la réalité du
jeu électoral, je continue un peu d’y croire…
J+1
(Lundi 16 mars 2020)
Autrement, l'ensemble du texte
est rédigé avant les résultats du premier tour
- et sans référence explicite à l'épidémie de coronavirus.
Une chambre
nuptiale (allégorie)
PARTIE I - L'ENS et les
limites de la raison occidentale
Introduction
: Un désir d’unité et de science
2001-2003
: le pari d'une reconversion
Octobre
2003 : une chambre noire
2004-2013 : Une occasion maintes fois manquée
Epilogue
: La Duchesse du Maine et l'Ordre de la mouche à miel
PARTIE II -
L'Alternative Sétoise, une répétition
Introduction (lettre
à Nicolas)
Un psychodrame (Défouloir du mardi 10 mars)
Débrancher
(Reprise du mercredi 11 mars)
> PARTIE I & II DORENAVANT VISIBLES SUR MON SITE "CONFINEMENT"
PARTIE
III - Un islam pour la France au XXIe siècle
Je
navigue à vue, dans une transition de mon histoire
personnelle et de
notre histoire collective, l'une et l'autre
s'éclairant mutuellement.
C'est
mon métier d'ethnographe de travailler comme
ça,
et je
ne sais pas faire autre chose.
Bref, je vais améliorer ce texte petit à
petit, car je veux faire quelque chose de ce moment
- tout comme j'ai fait quelque chose de la mort d'Ali Saleh
(fin 2017-début 2018), et du mouvement gilet jaune (fin
2018-début 2019).
PARTIE I - L'ENS et les limites de la raison occidentale
Intro : Un désir d’unité et de science
J-0
(15
mars). À terminer
L’histoire de mon enquête au Yémen s’inscrit dans un moment particulier dans l’histoire des sciences sociales à l’École Normale Supérieure (qui s’inscrit elle-même dans l’histoire des sciences sociales plus généralement). Jusqu’au milieu des années 2000, l’ENS de la rue d’Ulm hébergeait le Laboratoire de Sciences Sociales, fondé dans les années 1980.
Comme son nom l’indique, le Laboratoire de Sciences Sociales se pensait comme un « laboratoire », sur le modèle des sciences expérimentales. (C’était avant que cette appellation ne se généralise, et ne se trouve en quelque sorte galvaudée, comme les appels récurrents à « l’interdisciplinarité »…). Ce laboratoire entendait « expérimenter » au profit d’une conception bien particulière selon laquelle, au-delà des traditions disciplinaires particulières de la sociologie, de l’histoire et de l’anthropologie, il existe quelque chose comme « les sciences sociales », désignant en fait une seule science du « social ». Au lieu d’avoir des « instituts » ou des « centres d’études » (de telle ou telle problématique, époque historique ou région du monde…), au lieu que les chercheurs se définissent par telle ou telle méthode de recherche (la pratique des archives, des statistiques, ou encore de l’immersion ethnographique…), les chercheurs se mettaient à se penser comme spécialistes du « social » - un peu comme on peut être spécialiste des interactions électro-magnétiques…
Vers le milieu des années 2000, le Laboratoire de Sciences Sociales a cessé d’exister, à la faveur d’un rapprochement avec les économistes sur le campus Jourdan, où l’Ecole d’Economie de Paris était sur le point d’être créée. Une partie des chercheurs ont formé l’équipe ETT (« Enquêtes, Terrains, Théories »), qui s’est progressivement dissolue dans le Centre Maurice Halbwachs. Une autre partie s’est orientée vers l’IRIS, l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, fondé par les anthropologues Alban Bensa et Didier Fassin. Il est indéniable que ces interlocuteurs m’ont manqué, de même que la dynamique théorique qui était associée au LSS. Il n’empêche, c’est dans cette institution-là que j’ai été socialisé, que j’ai construit ma vocation pour les sciences sociales.
En tant qu’élève normalien entré par le concours physique, l’esprit de cette institution a produit sur moi un effet très fort. De manière un peu souterraine, j’ai passé les années suivantes à m’interroger sur la nature réelle du « social », de ces « interactions », à construire un contenu théorique cohérent, à l’épreuve d’une situation ethnographique particulière.
Le hic, c’est que j’ai abouti à quelque chose de très différent d’une théorie formelle - décevant en cela les attentes « scientistes » de ma discipline d’adoption. J’ai abouti à une conscience, qui n’a fait depuis que s’étendre : une conscience quant à cette situation ethnographique et quant à l’ordre du monde (*). Dans ma recherche, j’ai abouti à ce que les physiciens appellent « intuition » : intuition du système observé, intuition des outils intellectuels employés, de leur domaine de validité, et des limites de leurs approximations. J’ai acquis une conscience toujours plus aiguë, quant à l’inanité d’employer tels et tels outils dans tels et tels situations, ainsi qu’une conscience des effets induits de ce type d’erreur. Voilà qui était très gênant pour le fonctionnement des sciences sociales - et c’est pourquoi la suite n’a été qu’un dialogue de sourds. Pourtant je n’ai pas voulu savoir, je me suis obstiné, et à la fin j’ai été complètement plumé…
D’où l’effet « thérapeutique » de mon passage par l’Alternative Sétoise ces derniers mois (voir le récit de la partie II). Quelque part avec Véronique Calueba, j’ai cherché à reproduire l’expérience que m’avaient fait subir les sciences sociales - ce qui n’a pas manqué d’arriver. Mes camarades doivent cependant savoir que concernant le Yémen, mon intuition ne m’avait pas trompé. Et qu’il pourrait bien en être de même avec l’évolution politique de notre ville et de notre société… Pour ma part je reste sur mon petit chemin. Je le suis depuis bien trop longtemps pour en changer.
(…) To be continued…
(*) Par exemple, j’ai abouti à une conscience du caractère bien français de cette conception des sciences sociales - ce dont les Français eux-mêmes n’ont pas forcément conscience. Cette conception unitaire des sciences sociales est à rapprocher de ce qui définit la France d’un point de vue anthropologique - à savoir d’abord son rapport au catholicisme, central mais ambivalent (comme en témoigne l’expression de « fille aînée de l’Église ») ; une conception centralisatrice de l’État et la manière spécifique dont la France s’est extraite des guerres de religion, qui mènent directement à l’importance des Lumières dans ce pays.
Les
réalités
sociales yéménites sont délibérément écartées de ce texte. Leur
évocation ferait écran à la compréhension de l’intrigue, et de
son véritable enjeux : le rapport au réel des élites
occidentales.
Pour ceux qui
souhaiteraient approfondir, les
liens
précédé d’un # renvoient à la page « Les
clés
de mon enquête au Yémen »
(2019).
Alors comment en vient-on là, à se retrouver marié aux sciences sociales ? Ce cas relève-t-il de la psychose, ou de la structure même des institutions ?
2001-2003 : le pari d'une reconversion
Fiancé à 21 ans à peine, disais-je. Cette année-là j’avais fêté mon anniversaire au Yémen, en juillet 2001, où je me trouvais pour un stage linguistique avec la classe d’arabe de l’Ecole Normale Supérieure. À la rentrée suivante je me retrouvais à Orsay dans la cave d’un laboratoire d’Optique Quantique, pour mon stage de maîtrise au chevet d’une grosse manip - un enchevêtrement de pompes à vide et de lasers sur quelques mètres carrés - conçue pour piéger des atomes individuels par refroidissement Doppler. C’est dans cette cave - où l’on ne captait pas la radio - que j’appris qu’un avion de ligne s’était écrasé sur une tour de Manhattan. Quand le collègue descendit nous parler du second avion, je décidai de prendre mon après-midi et me rendis directement sur le campus voisin de l’Ecole Polytechnique, chez mon ami Mohammed avec lequel j’avais commencé à apprendre l’arabe trois ans plus tôt. Il m’ouvrit la porte, et nous vîmes ensemble les tours s’effondrer en direct à la télévision.
Quelques semaines plus tard, je négociai ma reconversion aux sciences sociales avec la direction de l’ENS. Comme prévu, j’allais passer les six mois suivants à Cambridge, pour un stage en Théorie de la Matière Condensée sur des dispositifs de bio-nanotechnologie - en suivant parallèlement des cours intensifs d’arabe avec les étudiants du département de Middle East Studies, et en m’aventurant timidement dans certains cours du Département d’Anthropologie Sociale. De retour en France à la rentrée 2002, j’intégrerais formellement le Département de Sciences Sociales de l’ENS, ainsi qu’une licence d’ethnologie à l’Université Paris X – Nanterre.
En m’aventurant dans les sciences sociales, j’avais bien conscience de m’embarquer pour une galère. J’avais été au lycée et, en tant qu’élève bon en maths, je savais bien que les matières littéraires étaient le règne de l’injustice et de l’arbitraire. (En philo de Terminale, se creuser la tête des jours durant sur le Discours de la Méthode ; découvrir que le texte doit être entièrement lu au second degré - « Le bon sens n’est PAS la chose du monde la mieux partagée… » - comme un texte à tiroir à visée initiatique ; rédiger mon devoir maison avec passion, tout excité de cette découverte, et se retrouver finalement tout juste avec la moyenne ! J’avais dû pas trop mal argumenter mon point de vue…) Entre les disciplines littéraires et moi, les rapports étaient cordiaux tant que chacun restait à sa place. En tant que matheux, j’étais censé apprendre de quoi discuter dans les soirées parisiennes, pour les marivaudages avec les étudiantes littéraires de l’ENS. De là à concevoir un véritable mariage, il y avait évidemment un pas…
Si je prenais ce risque, c’est du fait de ma passion pour la langue arabe et de mon expérience antérieure de la camaraderie scientifique transculturelle : pour l’accès au réel, je tenais là une avance potentiellement considérable sur les élèves littéraires, surtout si je partais enquêter dans une ville éduquée. Une avance nécessaire pour compenser le handicap que représenterait à coup sûr mon esprit rigoureux, et ma phobie des bibliothèques.
(dimanche 8 mars)
Octobre 2003 : une chambre noireAutant dire qu’en juillet 2003, à l’instant où je pose le pieds à Taez pour la première fois, je sais déjà que je joue ma survie intellectuelle. D’où mon comportement avec Ziad, dont j’avais décidé qu’il serait mon interlocuteur - et en fait le Régime l’avait décidé aussi, parallèlement (comme je l’explique ici). Depuis l’origine de cette recherche, l’ensemble de mes récits sont biaisés du fait de ce tabou sur ma formation initiale, et l’impossibilité d’évoquer ce contexte pré-existant. Je savais très bien ce que je faisais, en réalité, Ziad et son entourage s’en rendaient bien compte. Mais les sciences sociales m’ont toujours obligé à raconter une autre histoire. Pour intéresser la galerie, l’ethnographe doit toujours se couler dans la peau de Tintin reporter, explorateur naïf mais courageux, un pure cogito s’aventurant en terrain inconnu… En réalité, ce sont les sciences sociales elles-mêmes que j’entendais pousser dans ses retranchements, jusqu’aux limites de ses approximations - ce qui n’arrive jamais dans les albums de Tintin. Pour cela j’avais besoin de complices, et aussi un peu d’attirer les sciences sociales dans un traquenard… Or les Yéménites le sentent et ce sont eux qui se révoltent en premier, contre Ziad leur maître de cérémonie. Le produit de cette démarche, en #2003, est un minuscule Printemps Arabe centré sur ma subjectivité. Quelque chose qui n’a pas même de nom à l’époque dans le lexique des sciences sociales, un mouvement social OVNI… Quelque chose que pourtant je veux regarder en face, parce qu’il est le signe que les Yéménites comprennent, et que la voie de l’anthropologie symétrique est la bonne. Mais je ne peux le regarder en face qu’en revenant en France, à travers le passage à l’écriture… ajout le samedi 14 mars, J-1 : C’est là qu’il faut introduire une autre scène, qui s’est déroulée à Sanaa le 4 octobre 2003, trois semaines avant la fin de mon premier séjour d’immersion. Cette scène est le pendant de la « chambre nuptiale », car étroitement liée aux conditions de mon premier arrachement au terrain et à mon premier passage à l’écriture. Ce qui s’est passé là, comme dans une chambre noire, a permis la projection dans l’écriture de ce que j’avais vécu précédemment. Ça s’est passé le plus simplement du monde. Un peu avant l’aube, Waddah ouvre la porte de ma chambre pour me poser une question. Depuis le seuil, il appelle mon nom jusqu’à ce que je me réveille : « Vincent, Vincent… Réveille-toi. Je veux te poser une question… » Donc je me lève, en caleçon, et pendant que je me frotte les yeux, je replace qu’on est à Sanaa, et je replace qui est Waddah, je remobilise toutes les discussions qu’on a eu pendant les dernières 48h… Waddah est un cousin de Ziad du côté maternel, qui s’est exilé à Sanaa depuis quelques années. Je viens de passer huit semaines dans le quartier de son enfance, particulièrement mouvementées. Je suis monté dans la capitale pour souffler un peu, et Waddah s’est proposé de me venir en aide. La dernière discussion s’est terminé tard et j’ai préparé un lit pour lui dans le salon - mais en fait Waddah n’a pas dormi de la nuit. Il a le sentiment de se faire embobiner, que je l’encourage à parler et parler encore, sous hypnose en quelque sorte. Il veut donc me cueillir à froid pour voir ma réaction. Sa question est la suivante - et je sens qu’il est un peu gêné de la poser : « Est-ce que, dans la discussion hier soir, tu cherchais à établir un rapport sexuel avec moi ? ». La réponse est non, évidemment non. Mais le dire ne ferait que relancer le même manège que j’ai vécu à Taez. Réaffirmer mon honneur n’a plus aucun sens à ce stade, vu que tous mes interlocuteurs ont déjà perdu le leur. La question de Waddah a au moins le mérite de la franchise, et je choisis de la prendre comme une avance sincère. Je prends la main de Waddah et l’entraine dans le salon.
Il m’a fallu plus d’une dizaine d’années pour comprendre ce qui s’était produit dans cette interaction. Dans le sens où, une fois ce type de rapports installé entre nous, j’ai quasiment cessé de tenir mon carnet de terrain - je n’ai fait qu’annoter les pages précédentes de mes cahiers - et à l’évidence, ce travail a préparé la rédaction de mon premier mémoire. Mais concernant cette relation, j’ai simplement géré la situation au mieux - parce que Waddah n’allait pas bien du tout, et il n’était pas question de me laisser aller à l’introspection. Cet état de tension s’est maintenu lorsque, trois semaines plus tard, je me suis retrouvé du jour au lendemain à nouveau en France, dans les bras de ma petite amie. Et ce n’est que huit mois plus tard, ayant déposé mon mémoire et rompu avec cette celle-ci immédiatement après, que j’ai pu commencer à réfléchir. J’avais alors le sentiment que cette relation, dont je sortais, n’avait toujours été que mensonge. Un mensonge d’ailleurs étroitement lié à l’exercice sociologique. Je voulais laisser ce mémoire derrière moi, comme une première modélisation très imparfaite, et tout reprendre à zéro. Il m’était indispensable de retourner là-bas, bien que cela me faisait peur, de réaffronter « à froid » les protagonistes de mon enquête. Et étrangement dans ces circonstances, l’idée d’homosexualité m’a complètement rassuré. Mais ce n’était pas juste moi qui étais homosexuel, c’était tous les Yéménites - et c’était aussi mon père, décédé cinq ans plutôt d’un cancer, dont je voulais croire qu’il avait été provoqué par ce refoulement… Ça a été comme une révélation, un autre regard sur ma famille et sur le sens de toute ma vie. Je m’étais reconnecté avec ma « prime nature » (ma fitra, disent les musulmans…), quelque chose qui me liait à la société yéménite. Parce qu’en fait, tous les hommes étaient homosexuels, il fallait partir de cette base pour comprendre. C’est ce moment que j’appelle ici mon mariage avec les sciences sociales. Et de fait, j’ai rejoint là un point de vue féminin sur le monde social, dans une sorte de fusion subjective, dont je n’ai émergé que bien plus tard. Au fond entre mes 24 et mes 30 ans, j’ai effectué un cheminement analogue à celui des garçons yéménites : ceux-là grandissent dans les jupons de leurs mères et, à partir ce point de vue-là, comprennent peu à peu leur place dans la société des hommes. Moi j’ai fait ce cheminement à partir de la place du #Hawdh, qui est l’espace public par excellence. Mais cet espace public où l’on ne voit que des hommes, au Yémen, porte en lui quelque chose de très féminin, associé au pouvoir de l’Etat et à la modernité. Toutes les années suivantes, j’étais sur le trottoir et je ne dérangeais personne. J’avais la tête pleine de considérations sociologiques, de paramètres et d’hypothèses sur l’histoire sociale locale, que je tentais d’ajuster dans l’interaction. Les Yéménites m’aimaient bien, et globalement ils ont accompagné ce processus avec bienveillance. Ce n’est qu’après plusieurs années, vers 2007, que j’ai pu renouer avec le quartier de Ziad dans une forme de respect. En 2010, j’avais fini par sentir la famille de Ziad comme si c’était la mienne, à percevoir l’existence de femmes dont on ne m’avait jamais parlé, dont j’ignorais même l’existence. À partir de ce moment-là (fin 2010) ma présence au Yémen a été impossible. Avec ma situation matérielle à l’époque, je ne pouvais pas prétendre me marier, pas même prétendre rencontrer la jeune fille. Je savais qu’insister ne ferait que détruire ma relation avec eux. Alors je suis revenu affronter les sciences sociales, dans ce tête-à-tête que j’ai décrit plus haut.
Au fond l’enjeu de ce tête-à-tête, qui a toujours été latent dans mes rapports avec les sciences sociales, n’a jamais été que la qualification adéquate de cette relation, et de la place de la sexualité dans celle-ci. Comprendre que ce qui s’est passé avec Waddah n’était pas un simple « passage à l’acte » au sens psychologisant, mais un point de passage nécessaire. Et ce du fait de la nature des Régimes - le régime politique yéménite et le régime épistémologique des sciences sociales, les deux étant profondément intriqués. Au Hawdh al-Ashraf, tous les Yéménites qui me voyaient évoluer, savaient que ça devait se terminer comme ça. Ils tentaient de me le faire sentir, ils bottaient en touche, et c’est précisément cette pudeur qui me rendait fou. Si c’est finalement tombé sur Waddah, c’est que Waddah a fait ce qu’il fallait pour, du fait d’une logique familiale et politique indissociablement, et je l’ai en quelque sorte pris sur le fait. Dans la famille, Waddah était le premier petit-fils de la branche la plus proche du Régime (celle issue de la seconde épouse du grand-père, cf arbre de parenté). La famille de Ziad était autonome financièrement grâce au travail de Nabil, mais c’est la branche de Waddâh qui avait les relations les plus hautes dans la hiérarchie. En prenant en charge cet hôte français, cette branche entendait réaffirmer son autorité sur la branche de Ziad. Par ailleurs Waddah était apparenté, par sa grand-mère maternelle, à l’épouse d’un haut responsable qui était à la tête de la Police politique du Régime. C’est lui qui l’avait fait monter à Sanaa, pour servir d’agent d’accueil dans le bâtiment administratif d’une banque. Mais cela n’empêche en rien que #Waddah se soit retrouvé piégé subjectivement dans cette expérience. Et je ne pense pas que ledit Responsable l’ai compris, bien qu’il s’intéressait forcément à nos rapports. Dans l’interaction décrite ci-dessus, c’est finalement moi qui force la main de Waddâh, en voulant croire à la noblesse de ses intentions. Et à travers lui, je forçais aussi un peu la main du Régime, sans m’en rendre compte. Si j’ai pu peu à peu comprendre cette situation, c’est parce que je m’en suis remis corps et âme à Ziad, parce que Ziad lui « craignait Dieu », et que malgré l’injonction tacite d’une partie de son entourage, il refusa pour sa part de régler sexuellement cette situation (notamment en #2006, lorsque l’homosexualité était vraiment devenue ma seule perspective). Il en a payé le prix. Aujourd’hui, Ali Abdallah Saleh est mort et enterré. Le Régime Yéménite est définitivement détruit. Mais le Régime des sciences sociales, en apparence, tient encore en place… |
2004-2013 : Une occasion maintes fois manquée
Il faut bien comprendre que cet incident, survenu en octobre 2003, n’aurait dû en rien compromettre la poursuite de mon enquête, selon les règles tacites comme les règles explicites du milieu. Nul besoin de connaître les petits secrets des laboratoires de sociologie, ou de suivre les discussions de machine à café, pour savoir que la sociologie se conjugue presque toujours à des histoires d’amour, à des mariages souvent, parfois aussi à des divorces. (On verra plus loin le rôle central d'un couple analogue dans la campagne de l'Alternative Sétoise…). Fort heureusement, cette dimension est assumée pleinement par la discipline - sauf peut-être quand il s’agit de sociétés musulmanes… Pour ma part, j’ai tu cet incident jusqu’à la fin dans mes écrits académiques. Mais j’aurais été disposé à le décortiquer sur demande, puisque j’avais admis l’homosexualité dans ma vie personnelle dès 2005 ou 2006… Et même à travers cette censure, je ne fais qu’appliquer la méthode de la réflexivité ethnographique, la seule qui peut conduire les sciences sociales à une forme de scientificité. Je renvoie à l’article de Florence Weber publié en 1991 : « L'enquête, la recherche et l'intime ou : pourquoi censurer son journal de terrain ? ». J’étais bien parvenu à mettre en œuvre la méthode ethnographique au Yémen, sur un terrain où elle n’est pas pratiquée d’ordinaire. Florence Weber s’en était bien rendu compte dans mon mémoire, au-delà de cet incident particulier qui n'apparaissait pas. D’où le soutien institutionnel de l’ENS, que je conserverai jusqu’en 2013. En fait la résistance est venue d’ailleurs, de « l’État profond » des études arabes, en quelque sorte…
(une vidéo pour faire connaissance)
Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue de l’Islam Méditerranéen à l’EHESS, a assuré la direction de mon travail dès mon année de DEA (2004-2005) et jusqu’en 2012. Mais nos rapports sont loin d’avoir été simples au démarrage…
(une vidéo pour faire connaissance)
Il y a d’abord le jeu des circonstances. En juin 2004, Florence Weber commence par me renvoyer à Alban Bensa, l’anthropologue de service dans le DEA de Sciences Sociales - mais celui-ci est en train de prendre ses distances pour créer l’IRIS avec Didier Fassin. Il préfère finalement me renvoyer à Jocelyne Dakhlia, et il me l’annonce en plein mois de juillet, quand les universitaires sont en vacances, alors que je suis sur le point de repartir au Yémen jusqu’à fin octobre… Lorsque Jocelyne Dakhlia découvre ma sollicitation à la fin du mois d’août, elle commence par exiger que je revienne en France m’entretenir avec elle… Elle accepte finalement de m’inscrire sous sa direction, essentiellement par amitié et reconnaissance envers ma tante Anne-Marie Planel (fondatrice de l’IRMC de Tunis, dont Jocelyne Dakhlia avait été la première boursière, au début des années 1990).
D’une manière plus générale, j’ai un peu pâti d’arriver sur la fin d’une époque, celle du Laboratoire de Sciences Sociales, fondé dans les années 1980 à l’ENS de la rue d’Ulm, autour de la figure de Pierre Bourdieu. Au milieu des années 2000, Florence Weber est en train de s’allier avec les économistes, en lien avec le projet d’une future « Ecole d’Economie de Paris ». À l’été 2005, lors de l’attribution des allocations couplées, elle fait le choix de me parachuter à Aix-Marseille, où existe un pôle important d’études sur le monde arabe (notamment l’IREMAM), au sein de la MMSH. Mais je commets l’erreur (sur l’avis de Dakhlia) de solliciter un rattachement à l’IDEMEC, soit sous le mandarinat de Christian Bromberger - pas vraiment un grand adepte de l’ethnographie réflexive et post-moderne… - et je ne serai jamais adopté par François Burgat (fondateur de l’IREMAM), en dépit d’une certaine sympathie réciproque.
Perdu dans ce panier de crabes institutionnel, je me cramponne à Jocelyne Dakhlia, directrice particulièrement exigeante, de formation littéraire quasiment orthogonale à la mienne, mais en laquelle je peux avoir une confiance intellectuelle absolue. Au cours de ma première année de thèse (2005-2006), que je passe pour moitié à Taez, je reformule l’ensemble de mon projet de thèse autour de la problématique de « l’homoérotisme », à laquelle Dakhlia est en train d’apporter des contributions substantielles - voir son ouvrage de 2005, L’Empire des Passions. De l’arbitraire politique en Islam, et cet article publié ultérieurement dans les Annales : « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique ».
Mais il demeure que dans ma propre recherche, cette problématique de « l’homoérotisme » n’a de sens qu’en dialogue avec la méthodologie ethnographique. Or en juin 2007, ma participation au colloque Ethnografeast de Lisbonne fait flop un peu pour les mêmes raisons : Florence Weber s’est alors retirée du comité d’organisation, et Loïc Wacquant (de l’Université de Californie à Berkeley) n’a aucune envie de s’intéresser à mon travail. Je suis programmé avec les doctorants portugais, un jour avant le démarrage officiel du colloque…
Pourtant cette intervention avait pour moi une importance capitale, quatre ans après mon premier séjour, après douze mois cumulés de présence sur le terrain et deux années de thèse… « Vous devez partir aux Etats-Unis… », me dit Jeanne Favret-Saada, que je rencontre à Marseille en juillet à mon retour de Lisbonne : « Ce que vous essayez de faire, le monde universitaire français ne l’acceptera jamais… ». Le 19 août #2007, mon retour à Taez est salué par Ziad qui met le feu à la maison familiale. Je me convertis à l’islam au début du mois de septembre.
(Lundi 9 mars)
* * *
En re-parcourant aujourd’hui la période 2004 à 2007, ces années décisives pour ma socialisation scientifique et la (non)réception de mon enquête au Yémen, il m’apparaît flagrant qu’il n’y a pas eu de hasard : le milieu académique ne voulait pas de mon travail. Les hommes en particulier, ne voulaient pas de cette confrontation intellectuelle, de ce que cette situation ethnographique aurait pu leur renvoyer quant à leur propre posture. Quelles qu’aient été les raisons subjectives de cet évitement, il y avait là une impossibilité structurelle - mais qui ne pouvait être énoncée, tant ma recherche cochait par ailleurs tous les mots d’ordre à la mode dans le monde de la recherche (réflexivité, interdisciplinarité, engagement sur les questions de genre, etc.). Par ailleurs j’avais la tête au Yémen, je vivais peut-être dans une sorte de déni. Je préférais garder ma vision idéalisée des sciences sociales, plutôt que de renoncer à ce que j’avais trouvé là-bas.
J’étais bien conscient de m’installer dans une bataille au long cours, et je fis les choix qui s’imposaient : rapatriement chez ma mère en région parisienne, existence frugale, investissement théorique dans des disciplines connexes, et sur des questions épistémologiques fondamentales… En 2009, j’ai obtenu les 15 000€ de financement du Prix Michel Seurat, grâce à une candidature appuyée par les lettres de recommandation conjointes de Florence Weber et de Jocelyne Dakhlia. Mais sans interlocuteur scientifique assigné, je pouvais bien écrire une centaine de thèses différentes à partir de cette même histoire…
À la fin de l’année #2011, après que la Révolution yéménite eut donné corps à mes intuitions théoriques les plus inattendues, je suppliai Florence Weber et Jocelyne Dakhlia de bien vouloir se rencontrer, afin d’établir une complicité minimale quant à ma stratégie d’exposition. Il faut dire qu’à l’époque, Florence Weber était engagée dans un vaste chantier sur la prise en charge de la dépendance et l’étude ethnographique des politiques publiques. Quant à Jocelyne Dakhlia, elle était préoccupée surtout par la transition post-révolutionnaire en Tunisie, qui semblait se poser en des termes très différents qu’au Yémen. Mais au nom de l’unité des sciences sociales, j’espérais tout de même qu’elles accepteraient un court instant d’être mes hôtes, de converser devant moi sur cette histoire, qu’elles connaissaient l’une et l’autre parfaitement. La rencontre eut bien lieu, dans la Cour aux Ernests de la Rue d’Ulm. Les deux duchesses s’exprimèrent tour à tour, avec sobriété, elles s’accordèrent surtout pour dire combien ma demande était déraisonnable.
À Paris comme à Aix, l’histoire se termine sur des scènes analogues dans mes laboratoires de rattachement : regards fuyants dans les couloirs, messes basses à la machine à café. C’était en pleine affaire Merah, et l’on s’inquiétait que je ne finisse par poser une bombe un jour ou l’autre, sans se rendre compte de l’absurdité. Il était temps de lâcher prise. Mais pour aller où ?
Et puis il y a eu cette visite chez ma famille à Sète en février 2014, en pleine élection municipale. L’effervescence d’une coalition historique contre François Commeinhes, qui réussit le prodige de lui assurer sa nouvelle ré-élection. La société française n’allait pas bien. Alors j’ai voulu poser mes valises, avec l’espoir d’être utile ici.
(9 mars après-midi)
Epilogue : La Duchesse du Maine et l'Ordre de la mouche à miel
Au sud de la région parisienne où j’ai grandi, mon école primaire était située non loin du Parc-de-Sceaux. Tous les jours après déjeuner, on nous conduisait jouer là-bas en empruntant l’avenue de la Duchesse du Maine. Ce n’est que très récemment - alors que j’approche de la quarantaine - que je me suis renseigné sur l’histoire de ladite duchesse. Il m’est tombé entre les mains un dépliant des « Petites Nuits de Sceaux » (suite d’évènements culturels et musicaux financés par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, placés sous le patronage de ce personnage historique…) et j’ai voulu en savoir plus. À vrai dire, je n’aurais jamais prêté le moindre intérêt à cette histoire, si je n’avais fait cette enquête au Yémen, et traversé l’épreuve que je viens d’évoquer.
Cette dame, Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon, avait été mariée à l’un des fils de Louis XIV. Elle en tirait fortement ombrage car le Duc du Maine était un prince légitimé. La duchesse rendit la vie impossible au pauvre bâtard, et transforma le Domaine de Sceaux en une scène artistique et intellectuelle « alternative » - à la Cour de Versailles - qui semble avoir joué un certain rôle dans l’histoire intellectuelle de cette période. Les convives qu’elle réunissait autour d’elle, la Duchesse les présentait comme ses « chevaliers », issus d’un ordre imaginaire : « chevaliers de l’ordre de la mouche à miel ». Ironie affectueuse et lucide. Les mouches ne font pas de miel, et la duchesse le savait pertinemment.
Les sciences sociales sont héritières de cette condition, quand bien même elles s’acharneraient à l’oublier. En effet, l’ensemble de la culture européenne s’est développée dans une configuration analogue, à l’intersection des prétentions bourgeoises et d’une noblesse « fin de race », consciente de son inéluctable extinction. L’historien et sociologue Norbert Elias le montre bien, dans un livre que je découvre ces jours-ci : Mozart. Sociologie d’un génie (Seuil, 1997).
La culture occidentale n’a jamais pu transcender les conditions anthropologiques de sa propre émergence, et elle ne le pourra jamais. Le cas de Mozart l’indique tout à fait clairement, par sa position dans l’ensemble de la production musicale occidentale, qui comporte quelque chose d’indépassable. On pourrait dire la même chose de Descartes, et de cet accomplissement dans l’histoire des mathématiques que constitue l’algébrisation de la géométrie (le fait d’associer une équation à une courbe, représentée dans un repère cartésien…). Il est bien illusoire d’imaginer qu’il se reproduira un jour une révolution équivalente, dans ce domaine de la pensée que l’on nomme aujourd’hui mathématiques. Au contraire, la pensée occidentale n’en finit pas de combler les brèches introduites par Descartes dans sa compréhension du monde, ce dont découle largement le désastre écologique actuel. Pour en prendre la mesure, Gregory Bateson est un auteur important.
Cette fermeture des perspectives de la créativité occidentale, les Yéménites m’y ont confronté d’emblée. Dès mon premier séjour d’immersion, les Yéménites m’ont envoyé au tapis, pour reprendre la métaphore utilisée plus haut. Et c’est précisément la raison pour laquelle je suis revenu, année après année. Au fond de moi-même1, je savais qu’une confrontation de ce genre était la condition de toute science, qu’elle ouvrait donc une fenêtre.
Au fond, mon sujet de thèse sur « l’homoérotisme » des Yéménites n’a jamais été qu’une ruse pour éveiller l’attention d’une noblesse de cour décadente et endormie… Pour réinscrire un horizon dans les perspectives étroites du jardin à la française, j’ai utilisé ce subterfuge de mettre en scène mon homosexualité. En réalité, il n’a jamais été question que de mon mariage avec les sciences sociales. Et vous verrez que les dates coïncident, si vous lisez mes textes rédigés depuis vingt ans.
Bref, je repense souvent à la Duchesse du Maine, pour laquelle j’ai développé une sorte de sympathie. Je suis persuadé que « l’ordre de la mouche à miel » aurait été plus réceptif à mes efforts, dont ils auraient perçu la pudeur et la noblesse. Contrairement à cette caste égocentrique de diplômés du supérieur - la France d’Emmanuel Macron - qui se gargarisent à peu de frais de leur universalisme étriqué, et qui rivalisent de charité pour les migrants - en paroles surtout - faute de comprendre leurs propres concitoyens.PARTIE II - L'Alternative Sétoise, une répétition
Lettre à Nicolas (de l'Alternative Sétoise)
Sète, le jeudi 12 mars 2020
Cher Nicolas,
(j’envoie aussi à Marithé, dont j’ai trouvé le mail ce matin).
Je me suis remis à écrire il y a quelques jours, d’une traite, un texte que j’aimerais partager avec toi, par rapport aux discussions qu’on a pu avoir ces derniers mois, notamment sur l’extrême droite. Tu le liras quand tu auras le temps…
C’est un texte où je reprends mon histoire avec les sciences sociales, cette mésaventure qui m’a couté quinze ans de ma vie. Mais cette fois j’ai pris appui sur mon expérience avec l’Alternative Sétoise, et ça donne quelque chose d’assez nouveau. Pour dire vite, je me positionne en tant qu’homme, et plus en tant qu’enfant qui dit « C’est pas juste… ».
La première partie est rédigée d’une traite le samedi 7 mars 2020. La suite du texte est en chantier, mais en gros je m’achemine vers un plan organisé autour de figures féminines, qui sont aussi des figures du pouvoir. Ces femmes sont celles qui ont donné corps à ce « mariage », dans telle ou telle phase de ma petite histoire.
Le texte commence par l’évocation fortuite d’une figure féminine de l’Ancien Régime, la Duchesse du Maine (1), l'occasion d'un petit rappel sur ce que sont les sciences sociales d’un point de vue anthropologique.
Ensuite il est question d’une part de Florence Weber (2), la directrice du département de sciences sociales à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, d’autre part de Jocelyne Dakhlia (3), ma directrice de thèse. Et l’on comprend qu’en fait, ces rapports étaient toujours dictés par des considérations strictement théoriques et institutionnelles, il n’y a jamais eu véritablement conflit ni projection, de ma part en tous cas.
C’est pourquoi quelque part, j’avais besoin de passer par quelque chose comme « l’Alternative-Sétoise-avec-Véronique-Calueba » (4), une expérience qui a fonctionné comme un psychodrame thérapeutique, que je décris. Dans cette partie rédigée avant-hier, il y a un passage assez violent, que j’ai préféré retirer de mon site pour l’instant, par respect pour les militants qui se mobilisent ces jours-ci. Donc quand c’est marqué (…), vous pouvez lire le pdf en pièce jointe.
La dernière partie rédigée hier s’appelle « Débrancher » (5), et elle est plus apaisée. J’y développe une analogie profonde entre l’ethnographie et la politique, ce qui me permet de revisiter autrement l’alchimie de l’Alternative Sétoise, cette fois sur le mode de la moquerie bienveillante.
Le texte se conclut en évoquant ton travail et l’histoire du logo. Ce logo que j’avais proposé, avec les deux jouteurs, il vous poursuit et il vous poursuivra. Je pense que vous finirez par comprendre à quel point, plus que toute autre liste en présence, vous avez fait campagne pour le Rassemblement National. Pacull vous doit tout, et il va rafler la mise avec une économie de moyens magistrale. C’est quelque chose qu’il faudra assumer, ces prochains mois et ces prochaines années. J’espère que l’Alternative Sétoise ne s’éteindra pas, et qu’elle saura accompagner cette nouvelle page de l’histoire de notre ville, sans manichéisme, mais de manière intelligente et digne.
Porte-toi bien et à bientôt.
Vincent
Un psychodrame (Défouloir du mardi 10 mars)
Depuis mon arrivée il y a six ans, j’ai tout de même réussi à renouer les fils de cette histoire [cf Partie I], à en retrouver le sens de l’intérieur-même de la société française, à mieux comprendre du coup mes interlocuteurs yéménites et l’épreuve qu’ils traversent actuellement. Depuis cette grande île singulière, le monde m’apparaît aujourd’hui bien plus petit, et plus cohérent…
Pour autant, on ne m’a pas laissé être utile. Malgré les drames réels qui ont frappé la France entre temps, la société locale s’est trouvée incapable de réparer l’injustice que m’avaient fait subir les institutions académiques. Une injustice parmi beaucoup d’autres que la société française est incapable de réparer. Et c’est ainsi qu’à l’automne 2018, je suis allé grossir les rangs des mécontents. Pour faire de l’entrisme, diront certains… C’est aux gilets jaunes qu’il reviendrait d’en juger. Pour ma part, je me suis parfaitement retrouvé dans ce mouvement. C’est plutôt lui qui est entré dans ma vie, qui a complètement transformé mon travail personnel (voir ici). Par ailleurs en tant que scribe, j’ai été heureux de prendre soin de sa parole. Je n’ai rien cherché à y ajouter, je n’ai rien cherché à en tirer dans les institutions. Les nombreux comptes-rendus verbatim que j’ai rédigé sont partis dans la nature, et sans doute entre temps ont-ils été moissonnés par les sociologues. Moi j’ai juste fait en sorte que les beaux parleurs soient redevables de leurs mots, j’ai juste oeuvré pour que ce mouvement reste fidèle à lui-même un peu plus longtemps. Et de fait, je crois que nous avons fait du bon travail jusqu’au printemps dernier, avec un certain nombre de camarades du Bassin de Thau.
Après quoi j’ai rejoint l’Alternative Sétoise. (…)
(…) Après quoi j’ai rejoint l’Alternative Sétoise. Et bien sûr, j’entendais lui poser une sorte de défi, pas à Véronique Calueba mais au mouvement lui-même : le défi de rester fidèle à ses ambitions. Le défi de se mettre au service de la population, avec l’humilité et la rigueur réflexive d’un ethnographe, pour devenir le réceptacle de ses aspirations. Au début du mois de septembre, j’ai été brutalement mis à l’écart par Véronique et sa garde rapprochée, qui ne voulaient pas de cette présence encombrante. Début octobre je suis revenu par la fenêtre (les gueux comme moi n’ont pas honte, n’ayant plus rien à perdre…). Mais ce coup d’éclat, pour moi, était surtout une manière de renouveler ce défi, par delà l’élection de Véronique comme tête de liste. Je voulais que les troupes fraîches de Sèt’ensemble ne se découragent pas, que la confrontation ait lieu et que ce mouvement vive… De fait, nous avons travaillé ensemble pendant de longs mois et ce mouvement a vécu quelque chose, réellement. Je ne suis pas sûr cependant qu’il survive aux élections municipales : ni en cas d’échec, ni même en cas de victoire, ce qui serait encore plus grave.
On dira que je suis égocentrique, que je prétends incarner à moi seul la conscience de l’Alternative Sétoise… De fait, je doute de sa lucidité depuis quelques semaines, de sa capacité à se regarder elle-même de l’extérieur. Je vois un mouvement emporté par son enthousiasme interne, par la complaisance de l’entre-soi militant. Un mouvement que pourtant j’ai voulu accompagner, avec bienveillance et loyauté, plaçant ma foi en son intelligence collective, ce qui impliquait de mettre entre parenthèses mes propres diagnostiques. Malgré cette attitude constructive, dont pourront témoigner tous les militants sincères, j’ai été mis à l’écart délibérément, dans les coulisses de la quatrième votation. Au vu de ce que j’ai apporté à ce mouvement, de mon implication pleine et entière depuis la toute première réunion au mois de juin, cette exclusion aurait dû constituer un voyant rouge. Moi-même je l’ai vue arriver, et finalement j’ai laissé faire, faute de savoir renoncer à ma posture d’observateur. Puis j’ai fini par détourner le regard, gagné après coup par une sorte de dégoût. J’aurais pu tout accepter sauf ça : sauf qu’on me mette à l’écart en invoquant mon entrisme et ma radicalisation. Alors m’est apparu, dans toute son étendue, la vulgarité profonde de ces gens qui prétendent accéder aux responsabilités. Alors m’est apparu leur profond sectarisme, au sens anthropologique du terme : cette manière d’accueillir la fin du monde en célébrant la messe, dans l’entre-soi des convaincus. Alors m’est apparu le scandale de ce féminisme verbeux, à mille lieues de ce que pourrait représenter un féminisme en acte : apprendre à se battre en conscience dans l’arène du patriarcat. Un féminisme qui appelle à changer le monde depuis les genoux du Père Noël, et laisse le vieux bougre faire sa sale besogne, de la manière la plus fourbe et anti-démocratique qui soit.
Disons-le clairement. Le projet initial de l’Alternative Sétoise, tel qu’il s’énonçait aux mois de juillet-août, a été vidé de son sens par ces « votations citoyennes » : une mise en scène démocratique grossière, à travers laquelle une petite clique entendait garder la main sur la composition de la liste, via le jeu des étiquettes partisanes et la variable de la mobilisation. Faire en sorte que celle-ci ne compte en son sein, outre les compagnons de route habituels, que des bobos inoffensifs, dont la plume et l’idéalisme naïf seraient bien utiles dans l’écriture du programme. Cette manœuvre, dont l’auteur de ces lignes a été le complice malgré lui, a découragé chez les électeurs ordinaires l’intérêt qu’aurait naturellement suscité une proposition de gauche aux élections locales. Arque-boutée autour d’un soleil déclinant, d’une impossible transmission de leadership, cette petite clique s’est permis de prendre en otage l’Alternative Sétoise, de prendre en otage la gauche, et la démocratie plus largement. Elle a privé les Sétois de la campagne qu’ils pouvaient légitimement attendre, au terme de trois mandats de François Commeinhes et après le mouvement des Gilets Jaunes. Elle a laissé la droite s’installer dans une campagne de notables et de partis, construite à partir des appareils nationaux. Elle a laissé faire l’OPA de la droite bourgeoise locale sur le Front National, et du Front National sur la droite bourgeoise locale. [J'ajoute ce tract des militants RN, qui était distribué au Château Vert samedi 14…]. De sorte que la liste de Pacull ressemblait à un meeting du MEDEF - dixit un camarade Gilet Jaune qui y assistait à mes côtés, et qui pourtant lui accordera sans doute son vote, s’il se déplace pour aller voter. Car au regard d’une duplicité aussi malsaine, l’extrême-droite conserve au moins l’attrait du clientélisme le plus classique, le plus honnête, le plus rassurant.
L’Alternative Sétoise est déjà un échec de mon point de vue, avant même la sanction des urnes qui s’annonce cuisante. Le pire n’est pas dans cette débâcle en elle-même, le pire est dans la médiocrité générale de l’offre politique à cette élection locale, où l’Alternative Sétoise porte peut-être une responsabilité particulière. Et je ne sais dans quelle mesure je n’ai pas moi-même participé à cette catastrophe. Peut-être aurait-il mieux valu que Sèt’ensemble reste à distance, qu’ils se retirent fin septembre comme à l’origine ils en avaient l’intention, au lieu de rendre « gaga » le PCF local, dans cette étreinte incestueuse et complaisante. Qui sait si cette dynamique ne s’est pas finalement avérée plus excluante qu’autre chose, bien au-delà de mon cas personnel ? Qui sait si elle n’a pas empêché d’autres rapprochements et d’autres candidatures, autrement plus significatives pour le destin de Sète ? Cette dynamique « alternative » n’a-t-elle pas finalement soustrait au peuple Sétois, notamment à l’électorat populaire, un droit légitime d’arbitrage entre les différents partis qui sollicitent ordinairement ses suffrages ? Au terme de cette campagne, je doute. Je vois bien que les propositions n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Et je doute notamment en tant que Français de confession musulmane, connaissant bien cette capacité qui est la nôtre en Europe, de participer à l’enchantement collectif sans forcément y croire vraiment nous-même. Peut-être aurait-il mieux valu que je m’abstienne totalement, non pas de toute participation citoyenne, mais de toute participation au jeu électoral. Quelque chose d’un drame historique est ici à l’oeuvre, que j’étudie depuis de très nombreuses années. Un drame dont je ne peux m’extraire moi-même, et dont pourtant je ne cesse d’espérer que nous puissions ensemble le regarder en face, pour concevoir depuis Sète un nouveau chemin.
(Mardi 10 mars au matin)
Débrancher (reprise du jeudi 11 mars)
Par derrière, j’ai posé mes mains sur ses yeux. Je l’ai conduite à travers un dédale de couloirs et d’escaliers. J’ai enlevé mes mains, elle a découvert la chambre. Et derrière par la fenêtre, les vallées du Hadramout…
- Mais je dois plutôt décrire dans le monde réel, comment je me suis senti, il y a deux semaines quand j’ai eu débranché. Plus aucun mail du jour au lendemain - alors qu’il en arrivait au moins toutes les heures, de toutes les listes et sous-listes thématiques dont je suivais l’activité. Une sacrée usine à gaz tout de même, l’Alternative Sétoise ! Et voilà le démantèlement du monde, à portée d’un clic… Pourtant je restais lié aux autres, par un lien beaucoup plus fort en fait : un sentiment de rage, le besoin compulsif de les mettre à distance ; chaque muscle et tous les poils de ma peau, soudain mobilisés pour rétablir une barrière. J’ai senti que j’allais pouvoir m’occuper de moi, de mon corps. J’ai été heureux qu’il ne vienne jamais personne dans mon appartement : pour la première fois je n’attendais plus. « Cette fois j’ai divorcé pour de vrai ! », je me suis dit, et ça m’a donné l’idée de ce texte. Comme je prenais soin de mon corps avec des étirements, et que mes idées se mettaient progressivement en place, ce lien de rage s’est peu à peu transformé, en un lien de pudeur et de dignité : le rattachement à une conscience collective.
J’associe spontanément à un moment très précis de mon enquête : mon retour sur la Place du #Hawdh en août 2008, pour mon cinquième séjour. Depuis 2003 j’avais passé environ quinze mois là-bas, essentiellement sur cette place. Une période de ma vie où je m’en remettais entièrement à mon enquête, à ce lieu où des personnes menaient leur existence, des hommes yéménites, qui n’avaient rien demandé… Je passais là de longues périodes, j’étais sur le trottoir, je ne dérangeais personne. J’avais la tête pleine de considérations sociologiques, de paramètres et d’hypothèses sur l’histoire sociale locale, que je tentais d’ajuster dans l’interaction. Les Yéménites m’aimaient bien. Je crois qu’ils me prenaient un peu pour un fou, bien qu’ils n’avaient pas beaucoup d’Occidentaux pour comparer, ils me prenaient en tous cas pour quelqu’un de perdu. C’est sur cette place que l’année précédente, je m’étais converti l’islam, dans des circonstances tout de même très particulières. Puis j’avais passé une année en France, un converti OVNI, découvrant soudain l’ampleur de sa solitude. En 2008 le jour de mon retour, j’ai débarqué avec mes valises sur cette place, comme d’habitude, devant mes amis commerçants. Mais j’ai réalisé très vite que je ne pouvais pas rester là, je ne supportais plus ce lieu. Je les aimais beaucoup, et je n’avais rien contre personne, mais ce lieu me brûlait le visage. J’ai passé ma première soirée dans une chambre, à l’hôtel où je descendais d’habitude, et le lendemain j’ai loué un rez-de-chaussée de villa, un peu à l’écart dans un quartier plus chic. Ma famille arrivait deux semaines plus tard, pour me rendre visite au Yémen pour la première fois, et je ne voulais pas les exposer en ce lieu. J’étais un peu devenu yéménite quelque part… Le reste de ce séjour de #2008, j’ai travaillé sur ma thèse. Je ne venais au Hawdh que quelques heures par jour, essentiellement pour me rendre au chevet de Ziad qui venait de sortir de prison, tenter de comprendre cette soi-disant schizophrénie… Les amis commerçants ne me virent quasiment plus, et ce sont eux qui venaient rôder parfois dans mon secteur. Inutile de dire que cette année-là, ma compréhension de la société yéménite prit une tout autre dimension.
C’est l’ensemble de cette expérience qui a fait de moi un sociologue, quelqu’un qui sait percevoir le « social » - qui ne le confond ni avec les représentations intellectuelles du monde qu’il peut entretenir par ailleurs, ni avec ses propres projections affectives, en situation. Jeanne Favret-Saada l’explique très bien dans « Être affecté », un article méthodologique devenu la pierre angulaire de l’ethnographie française : c’est à la fois le fait d’être pris, de s’être dépris, et de se donner ensuite les moyens d’opérer une reprise. Toute recherche doit nécessairement passer par ces étapes, dans l’enquête ethnographique telle qu’elle se conçoit aujourd’hui - afin de prétendre connaître une petite parcelle, dans ce monde éclaté du XXIème siècle…
Et je pense qu’en politique il existe un enseignement analogue, que connaissent les vieux militants des partis. On ne peut pas gagner les élections du premier coup. On ne peut pas se réveiller un matin, et inventer le projet miracle qui suscitera l’adhésion générale. Il faut faire des campagnes, subir des déconvenues, et se relever. Il faut que le réel résiste. Il faut qu’un collectif se constitue, avec ses propres règles tacites, ses règles éprouvées, qui ne peuvent pas être « débattues démocratiquement ». La déduction seule est vouée à l’échec, et l’induction ne peut suffire, fut-elle sincère : c’est toujours par abduction que se rencontre le succès électoral. Il faut qu’un collectif plonge au plus profond de lui-même, et y trouve les ressources pour faire les bons choix. C’est ainsi qu’on prend le pouvoir en Occident, où s’est construit le système des partis. Cela est directement lié à l’influence des guerres de religions, à la manière dont les États européens ont reconstruit leur stabilité en entretenant une forme de chaos régulé - le fameux Léviathan de Thomas Hobbes… Depuis cinq siècles environ, la politique occidentale repose sur l’incitation à construire des mouvements sectaires, orientés vers la prise de pouvoir, et qui régénèrent périodiquement l’Église dominante. Ce sont des considérations anthropologiques qu’il vaut mieux avoir en tête, pour comprendre cette fameuse « crise des partis » que les médias nous rabâchent.
Dans cette aventure de l’Alternative Sétoise, je repense à certaines scènes où les certitudes partisanes refaisaient brièvement surface - bien que toujours refoulées officiellement : il s’agissait d’une liste « citoyenne »…
Je vois encore l’excitation électrique de Véronique, à l’AG du 29 août au Palace, pour laquelle le PCF avait mobilisé ses troupes. La première réunion de l’été où la Reine daigna paraître, et déclarer formellement sa candidature. Je me souviens de sa morgue lorsqu'elle ajouta, comme pour montrer ses muscles de militante : « Moi je ne suis pas du genre à faire campagne derrière un ordinateur… ». Et moi comme d’habitude au premier rang, qui notait tout… Tout l’été nous avions commencé à refaire le monde, et Véronique n’avait envoyé que ses lieutenants (Olga, Gabriel…). En fait c’était douloureux pour elle, mais je n’étais pas capable de le comprendre à l’époque. Ce monde de la politique nous était totalement étranger - sauf pour Raphaël, qui par son travail avait évolué dans les milieux syndicaux, et de fait il fut l’un des artisans de cette rencontre… En fait nous leur faisions peur, notre génération de « jeunes » déjà quarantenaires - alors que nous ne demandions qu’à apprendre, que l’on veuille bien nous parler, réfléchir avec nous… Contrairement aux vieux militants du 51 (rue Pierre Sémart, plutôt venus d’EELV), nous ne nous sommes jamais formalisés des attitudes partisanes du PCF. Car au fond nous n’avons jamais connu que ça, ces institutions déjà verrouillées, avec aucune place à prendre, mais néanmoins avides de visiteurs « pour le plaisir des yeux », car doutant de plus en plus de leur raison d’être… Alors nous avons été les hôtes du PCF, et c’est nous finalement qui les avons apprivoisés.
Nous avons aussi adopté Gabriel, le jeune et fringuant directeur de campagne, imposé par Véronique au lendemain de son élection. Ancien combattant du collectif « Une marina pour qui pour quoi », censé représenter à lui seul la relève du Parti Communiste Sétois… Et le voilà donc dans la position du Papa, rythmant les réunions de coordination avec son excitation de cocker (exactement comme le papa dans les albums de Boule & Bill, coiffure comprise…). Il est épaulé par sa fidèle épouse Laura, jeune et brillante Maître de Conférence en « Démocratie » - mais pas sociologue pour un sou, en tous cas pas assez pour questionner l’efficacité réelle de ses « porteurs de paroles », ni pour voir où était le problème avec sa position de chercheuse, d’un point de vue éthique.
Véronique, Gabriel, Laura. Voilà la « clique » à laquelle je faisais référence hier. Elle n’est pas bien méchante, plutôt pleine de bonne volonté. Elle a commis des bourdes phénoménales, avec le Midi Libre notamment. La directrice d’agence Mme Froelig les trouvait horripilants à souhait, et ça s’est senti dans la couverture du quotidien régional. Il n’empêche que sans cette clique, il n’y aurait simplement pas eu de campagne. Elle a été le moteur de l’Alternative Sétoise, le coeur battant, au sens le plus mécanique du terme : pousser dans un sens, puis dans l’autre, dans les veines puis dans les artères, avec la régularité d’un métronome. À l’évidence, ceux-là étaient portés par une foi d’un autre ordre : pas la foi d’une sincérité extravertie ou d’un absolu idéologique, une foi plutôt liée aux vertus de la régularité, de l’obéissance et de l’abnégation. Cela s’appelle la discipline de parti.
Et c’est à travers cette discipline que François, effectivement, gardait un certain pouvoir sur le cours des évènements. De fait lors des votations citoyennes, c’est essentiellement lui qui déplaçait les électeurs. On ne peut pas dire pour autant que « l’arrière-garde » conservait le pouvoir. Pour Véronique et Gabriel, cette discipline était simplement liée à la conscience de travailler dans une filiation, d’être les heureux dépositaires d’un legs. J’ai fait du porte-à-porte avec Véronique : malgré vingt ans de vie politique, elle avait conscience de marcher dans les pas de François Liberti, presque à chaque instant. Par rapport à nous, cette conscience les plaçait dans une toute autre temporalité. Gabriel nous disait souvent, au mois d’août, que c’était sa première campagne : il partait du principe qu’il y en aurait beaucoup d’autres, et c’était pour lui comme une évidence. Pour nous autres, cette campagne était la première et aussi la dernière déjà : dans six ans nous ne savions pas où nous serions, ni où en serait le monde, donc c’était cette fois ou jamais. Gabriel ne voyait pas à quel point cette certitude, pour quelqu’un de sa génération (né je pense vers 1990), le plaçait en décalage total avec la réalité française, et d’emblée comme un « fils de », un héritier casé quelque part, avant d’avoir pu connaître le monde. Mais encore une fois, il en fallait un comme Gabriel, une bête de somme. Nathan Liberti par exemple, bien qu’il fut le petit-fils de son grand-père, n’aurait jamais pu jouer ce rôle. Avant de se réaliser comme colleur d’affiches et de faire d’autres rencontres, il avait souvent l’air de se demander ce qu’il foutait là… Pourtant après quelques mois, la mayonnaise avait pris :
De ces doutes, de ces tensions internes et des cheminements qu’elles ont permis, il n’est jamais rien apparu dans la communication externe de l’Alternative Sétoise. Une communication lisse, souvent même consensuelle, voire bien-pensante. Et pour tout dire une communication insuffisante, tant nous étions occupés à cadrer l’énergie interne. La liste de discussion débordait, de déclarations existentielles et de « Moi je… », mais tout cela était filtré d’une main de fer, au point qu’à l’extérieur il ne paraissait quasiment rien. Début septembre, j’avais proposé ce logo - je peux bien le ressortir aujourd’hui… :

À mes yeux, l’image représentait parfaitement notre mouvement : l’espoir d’une nouvelle mixité sétoise, d’une vitalité démocratique renouvelée, née de l’alliance des contraires et du fair-play de la compétition sportive. Le logo a été jugé trop agressif, et conflictuel. Véronique avait terriblement peur que le bateau lui échappe. D'ailleurs c’était assez ingérable pour Manuel, notre attaché de presse à l’époque, qui allait bientôt prendre ses distances. Manuel s’est concerté avec Nicolas, le graphiste, qui venait de débarquer. Finalement le logo a pris cette forme :

Dans ce logo, je me suis toujours identifié au cerf-volant. Ils ont lâché la ficelle dans la dernière ligne droite, sans se demander ce qu’il adviendrait de moi. J’ai tout de même reçu dans ma boite mail l’invitation au dernier meeting, avec toujours le même brin de folie du graphiste… De l’extérieur, j’ai du mal à croire que cet « Alter-meeting » puisse être en phase avec l’humeur des électeurs (voir la com’ de Pacull en comparaison…). Pour autant je connais leur sincérité. Ils y croient et c’est très bien, même si ça doit me rester étranger.
(Mercredi 11 mars au matin)

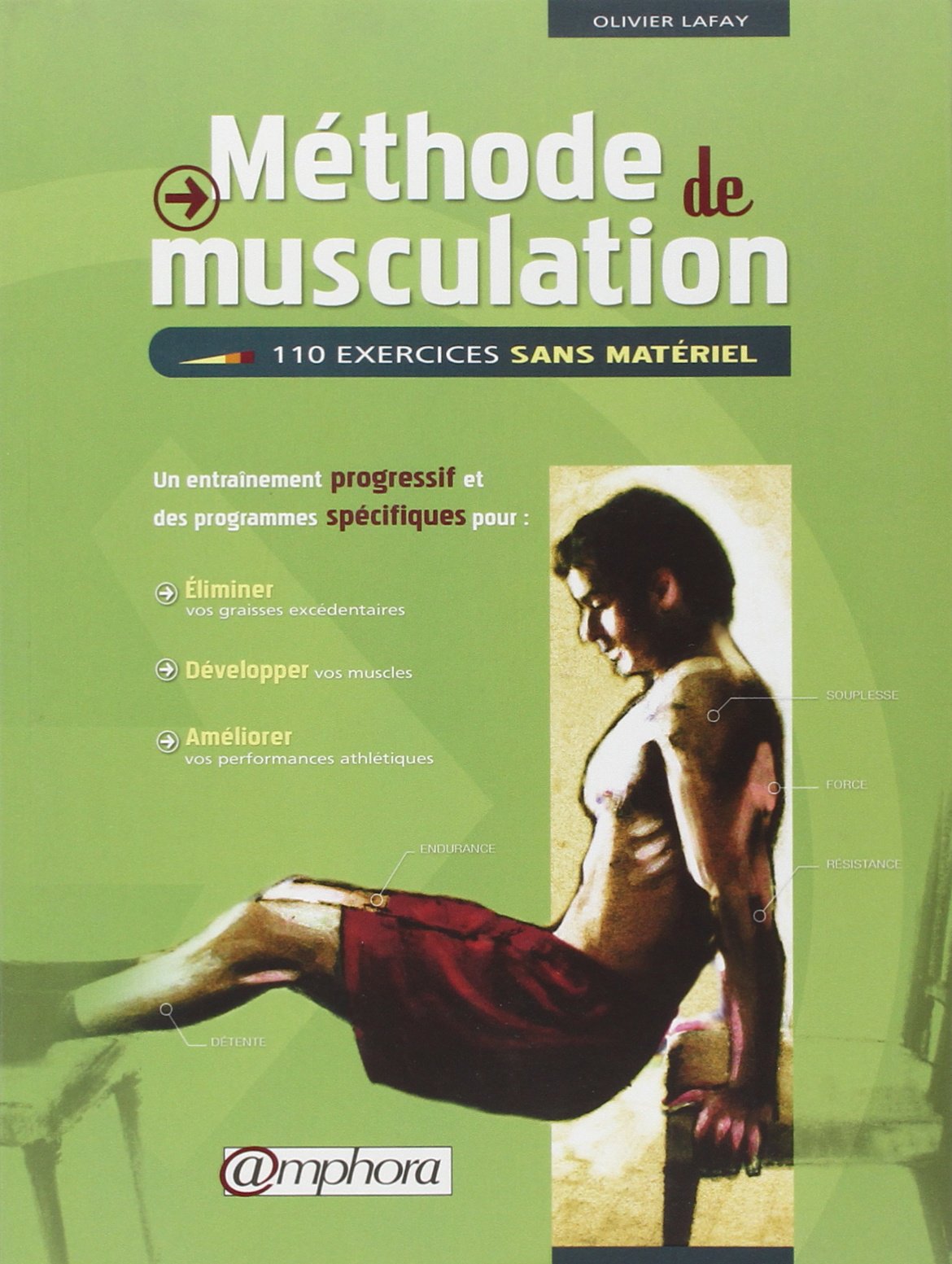 |
|
1Dans mon enfance, en lien avec une histoire familiale où la musique jouait un rôle important (voir ici), j’avais été confronté très tôt à cette fermeture des perspectives de la créativité occidentale. Bien avant la confrontation au cadre scolaire, mes toutes premières pensées conscientes étaient hantées par la question du génie musical : une « oreille absolue » dont j’étais censé avoir hérité, mais dont il m’était évidemment impossible de faire quoi que ce soit, tant cette question concentrait en elle tous les équilibres et toutes les contradictions de notre famille recomposée (selon une configuration bourgeoisie / noblesse assez analogue, entre le côté paternel et maternel). D’où le report de cette problématique sur l’école, où cette question de l’intuition (pas seulement musicale) m’a guidé jusqu’au sommet de la hiérarchie scolaire. Et c’est là, dans une classe préparatoire en plein coeur du cinquième arrondissement, qu’intervient ma rencontre avec le monde arabe en la personne de Mohammed Amine, petit génie des mathématiques boursier de l’État tunisien…
PARTIE III - Un islam pour la France au XXIe siècle
Premier jet à J-0 (15 mars 2020), à peaufiner
Je me suis beaucoup éparpillé ces dernières années, entre différents projets d’écriture.
Parfois sur le Yémen, en revisitant une expérience de terrain à plus de dix ans d’intervalle (chantier scène primitive en 2018, clés et projet d’association en 2019) ;Parfois sur la société française au gré de l’actualité, en écho avec mes propres expériences (retour sur l’affaire Merah en 2017, Gilets Jaunes en 2018-2019, puis mes contributions dans le cadre de l’Alternative Sétoise).
Je voudrais maintenant me recentrer sur les fondamentaux que sont pour moi l’anthropologie et l’islam. Je voudrais montrer ce que j’ai à apporter en tant qu’anthropologue et en tant que musulman, en tant qu’anthropologue-musulman.
Un peu comme dans une méthode de musculation, je voudrais expliquer ce qu’est l’islam, dans le langage des sciences sociales. Non pas comme le ferait un anthropologue de l’islam : plutôt l’islam tel que l’ethnographie me l’a fait comprendre, en tant que pratique située de la citoyenneté.
Sachant que citoyenneté n’équivaut pas à participation au jeu électoral, il faut le préciser d’emblée… (Ma participation depuis 6 mois à l’Alternative Sétoise était liée à des circonstances extrêmement spécifiques, notamment à sa vocation initiale de faire une place aux citoyens. J’ajoute que cette participation s’est soldée par un échec, aussi bien pour l’Alternative Sétoise que pour ma contribution citoyenne, et ce n’est sans doute pas un hasard)En quelque sorte, j’entends construire l’islam en tant qu’ideal-type de citoyenneté (et même d’éco-citoyenneté peut-être). Et ce, à destination de Français musulmans aussi bien que non-musulmans (un peu comme une méthode de musculation, qui s’adresserait à de véritables sportifs comme à des amateurs, ou à des praticiens d'autres disciplines sportives).
Je crois en effet que l’islam est déjà, de facto, un modèle tacite de citoyenneté - un exemple de positionnement social et de parole appropriée. Il l’est dans nos écoles, sur les lieux de travail, et dans la société très généralement. C’est à l’invisibilisation de cette évidence qu’il faut plutôt réfléchir, à ce que cela dit de la société française, de son histoire et de sa réalité anthropologique, comme de sa situation actuelle.
Dans le moment de basculement que nous traversons, je souhaite rendre hommage à la citoyenneté silencieuse des musulmans de France, tout au long de ces années qu’on a associé au terrorisme islamiste - mais qui étaient surtout des années « en attente », d’autre chose, qui nous arrive finalement depuis une année. Ma propre histoire raconte aussi cela.
Je souhaite également pointer certaines erreurs d’analyse, commises de manière récurrente chez les musulmans diplômés, et dans ce qu’on considère parfois comme une pensée musulmane d’expression française.
Je veux notamment dire que, si la contribution des musulmans à la vie des institutions académiques est souvent heureuse, si elle est indéniablement nécessaire, cette contribution ne saurait constituer à elle seule une pensée musulmane de notre temps. Et encore moins les tentatives « à la hussarde » de mobiliser ces disciplines modernes au profit d’une vision du monde prétendument musulmane, à vrai dire étroite et obsolète, hors de tout effort de réflexion épistémologique et historique, en fait de tout ijtihad intellectuel. Depuis treize ans, j’ai appris à reconnaître ceux qui parviennent à naviguer entre ces deux écueils. Ils sont nombreux, bien qu’invisibilisés pour des raisons structurelles (je recommande un article de Jocelyne Dakhlia (qui était ma directrice de thèse), paru en 2006 : « Musulmans de France, l'histoire sous le tapis »). En fait, il n’y a aucune raison que cela change - mais mon but personnel n’est pas là.L’essentiel est que ces personnes, par la réflexion qu’elles produisent, agissent de manière située - située dans la société française réelle. C’est la dessus qu’il convient d’insister. La sociologie en a l’habitude, mais elle insiste d’une manière qui revient à faire l’apologie de son propre point de vue sur le monde, sans même qu’elle s’en rendre compte. Il n’y a pas lieu non plus de former un club selon une logique communautaire, qui n’apporterait pas grand-chose ni à cette pensée ni à son ancrage en France. Il y a juste urgence à produire une apologétique musulmane située dans la société française, qui soit simultanément une apologétique de l’islam et de nos institutions laïques. Je crois pouvoir la produire, à la faveur d’un croisement entre ethnographie, systémique et théologie.
En même temps, je nourris ce projet depuis de longues années : pourquoi aboutirait-il maintenant ? Parce qu’il ne pouvait aboutir qu’à partir du corps, et que cette fois le corps en sera le fil conducteur.

